 |
||
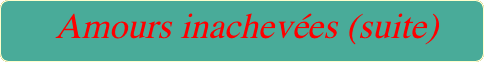 |
||
Le dîner eut lieu peu de jours après sans que j’eusse trouvé entre temps aucune occasion de revoir Mlle de Vegard. Ce fut une soirée mémorable, parce qu’elle marqua entre les parents de Marthe et les miens la renaissance d’une amitié de jeunesse, affaiblie par l’âge et les séparations et qui devait avoir sur mon amour une influence décisive. Ma sœur avait été invitée. Chacun se trouva dès l’abord à son aise. Marthe, Catherine et moi, nous mêlâmes peu à la conversation, qui roulait sur un passé que nous ignorions. Mais de voir à nos parents tant de souvenirs communs nous rapprochait comme les enfants d’une même famille. Je reçus de Mlle de Vegard une lettre très simple où elle me disait son amour. Je ne m’étonnai pas de cette déclaration, que j’attendais depuis quelque temps déjà, et que ma timidité seule m’avait empêché de formuler le premier. J’écrivis aussitôt à la jeune fille pour la rassurer à mon tour : je pouvais même ajouter que je connaissais par elle l’amour pour la première fois. J’étais alors sincère et ne me trouvais nullement abusé, puisque aujourd’hui encore, je vois toujours dans cette aventure sentimentale, venue après tant d’autres, ma première rencontre avec le véritable amour. C’es aveux n’apportèrent dans nos rapports aucun changement et nous n’en parlâmes pas lorsque nous nous revîmes. Mais le temps où il nous fut à l’un et à l’autre révélé que notre amour était partagé, coïncida avec une période où nos parents se virent beaucoup. Il y eut plusieurs repas à la maison, quelques déjeuners chez M. de Vegard, et nous passâmes souvent la soirée les uns chez les autres. Ma sœur et Marthe se voyaient aussi de temps en temps, et il m’arrivait de les accompagner : nous faisions des courses, visitions des expositions ou allions au concert. Enfin M. et Mme de Vegard me firent inviter aux bals où ils amenaient leur fille (Catherine, un peu plus jeune que Marthe, n’allait pas encore dans le monde cette année-là). Ce furent des heures sans histoire et dont il deviendrait vite lassant de rapporter le contenu uniforme. Je voyais si souvent Marthe que je ne trouvais pas le temps de trop souffrir de ses courtes absences. La certitude de la retrouver dans un proche délai me faisait toujours prendre ma solitude en patience. Mais je n’étais à proprement parler jamais seul : Marthe demeurait présente en moi, et ce m’était souvent une aussi grande joie de considérer en mon cœur son image que de la voir à mes côtés. Toute idée de machination amoureuse avait disparu de mon esprit : je ne faisais plus de projet, ne songeais pas à l’avenir. Le temps actuel suffisait à m’occuper ; mon amour l’emplissant tout entier, je m’abandonnais sans arrière-pensée à ma passion sans histoire. Marthe et moi ne désirions rien d’autre que notre mutuelle présence : aucun événement ne pouvait troubler la joie que nous avions d’être réunis. Il semblait ne se rien passer entre nous parce qu’il ne se pouvait rien passer qui ne nous demeurât intérieur. Seule comptait à nos yeux l’agitation merveilleuse qui nous tenait en haleine. Certains morceaux que la jeune fille me jouait sur son phonographe cet hiver-là me rappelèrent toujours par la suite la vie que je connaissais alors. Un monde nouveau m’apparaissait, où chaque être semblait d’une beauté singulière et toutes choses contenir un principe de bonheur. Le temps n’avait plus la même cadence : il allait tantôt lentement, tantôt fuyait par bonds rapides. Mais les minutes écoulées ne me semblaient pas perdues, car chaque instant contenait la même douceur, et j’espérais de l’avenir un état d’euphorie que le passé m’avait déjà fait connaître. Je croyais pouvoir compter ma vie entière sur cette joie ; assez nuancée d’un jour à l’autre pour que je ne m’en lasse jamais et cependant toujours semblable à elle-même. L’amour bougeait en moi comme un être vivant. J’éprouvais parfois un plaisir si excessif que je croyais ne pouvoir pas résister longtemps : il fallait à tout prix me délivrer de cette émotion. Mais au moment où je ne pouvais plus supporter une félicité trop intense, les obligations de la vie venaient heureusement me distraire de moi-même. Parce que je négligeais parents et amis, je n’étais pas libéré de toute contrainte : il me fallait sacrifier quelques heures à un travail pressé, prendre des inscriptions à un examen, assister à un déjeuner que je n’avais pu éviter. Je devais donc me replonger dans l’existence, redevenir semblable aux autres hommes, soudain aussi borné qu’eux, menacé comme eux par la tristesse et l’ennui. Dès que j’avais pu échapper à ces exigences sociales, je retrouvais en moi cet amour que j’avais dû abandonner quelque temps : pendant que je me livrais à ces travaux, il était demeuré au fond de moi-même, presque silencieux : ç’avait été le sourd murmure de sa présence que ponctuait parfois un cri plus pressant, quelque appel angoissé. Mais c’était à nouveau maintenant l’immense rumeur qui me recouvrait tout entier et dont j’étais assourdi. Marthe s’identifiait à ce grondement qui s’amplifiait en son absence et me laissait, lorsqu’elle était là, un peu de répit. Il était difficile, quand nous nous trouvions ensemble, d’échapper tout à fait à des gestes et des phrases, parasites insupportables de notre amour : mais nous demeurions souvent sans mot dire, et, le plus possible, immobiles. La musique nous donnait un prétexte de nous taire : nous en venions à l’aimer moins pour elle-même que pour le silence miraculeux qu’elle imposait au monde. Du moins, telle était mon opinion, et je l’attribuais également à Marthe sans chercher à savoir si elle correspondait bien à sa pensée intime. L’amour que Marthe avait pour moi, celui que je ressentais à son égard étaient mêlés d’autres sentiments auxquels ils eussent pu emprunter de leur noblesse : il y avait ma sœur, il y avait l’amitié de nos parents, la confiance qu’ils mettaient en nous. Mais il ne nous était pas besoin de faire appel à ces forces, bien capables à elles seules de tempérer la plus furieuse passion : nous nous suffisions l’un à l’autre, nous nous occupions de choses indifférentes, échangions de vagues paroles. Et pourtant, c’était cela, notre amour : être ensemble, écouter le son de nos voix, guetter au fond de l’être ce flux sans cesse renouvelé … Peu nous importait de rester seuls ou non. Mais nous recherchions à notre insu la compagnie de Catherine. Nous nous sentions rassurés auprès d’elle : sa présence nous défendait d’une part obscure de nous-mêmes dont nous ne songions pas encore à nous méfier et contre laquelle nous mettait en garde un sens intime qui nous demeurait caché. Je ne m’étonnais pas de la pureté insolite de ma nouvelle passion, mais bien plutôt de ce que j’avais appelé autrefois du nom d’amour. L’idée d’effleurer Marthe de quelque geste ne me venait pas et j’eusse même trouvé monstrueux de la salir de la moindre pensée trouble. Le jeune que j’avais été naguère ne se souvenait plus de sa déchéance passée. Cette part d’enfance qu’il avait cru perdue pour toujours renaissait et cette délicatesse première. La seule approche de Mlle de Vegard, dès le premier soir, m’avait transformé. Ebloui de la fraîcheur nouvelle de ma vie, je ne me lassais pas de considérer en moi ce miracle : l’innocence que j’avais vu fuir, semblait-il, à jamais, elle redevenait présente en moi, s’affirmait chaque jour davantage. Et c’était bien d’un miracle qu’il fallait parler : le changement qui s’était opéré avait été immédiat, total ; je n’avais pas eu à me soigner, mon mal n’avait connu ni rémission, ni convalescence. La seule approche d’un cœur sans souillure m’avait guéri … Ce sentiment je le portais déjà en moi, à mon insu, le soir où, au cabaret, j’avais repoussé Michelle – et c’était déjà lui (je le savais maintenant) qui m’avait empêché d’abord de téléphoner à Jean-Louis, ce confident habituel de mes trop faciles amours. Il m’était doux de penser au détachement où j’avais pu atteindre la seconde fois que j’avais vu Marthe : tout ce qui était demeuré étranger à ma contemplation m’était devenu indifférent, et j’avais oublié jusqu’au nom même de l’amour ! Mais, comme le pécheur repenti qui eût aimé effacer jusqu’au souvenir de ses fautes d’autrefois, je souffrais de ne pouvoir apporter à l’être aimé un cœur qu’aucune atteinte n’aurait jamais sali. Les jours se succédaient, apportant avec eux les mêmes chastes plaisirs : ces courses avec Marthe et Catherine, ces soirées toutes semblablement merveilleuses parce que notre amour les embellissait toutes. Je connaissais une vie intense où il n’y avait nulle place faite à l’ennui, une agitation perpétuelle ne me laissant jamais en repos. Mes facultés étaient étrangement accrues et j’éprouvais des impressions à la fois plus multiples et plus nuancées. C’est ainsi que ma seule oreille me révélait un monde singulièrement complexe dont je n’avais jamais soupçonné la diversité. La rumeur quotidienne de la vie m’était une musique adorable où la moindre note éveillait des résonances profondes. Il suffisait pour me bouleverser d’un seul cri dans la rue ; ma conscience s’abîmait dans la sensation présente ; pour un instant, il ne subsistait du monde et de moi-même que cet appel venu du dehors : un marchand d’habits le poussait et sans doute ignorait-il le sens de sa voix gutturale ; moi-même qui le saisissais, aurais-je su dire ce que je comprenais ? Mais je ne m’interrogeais pas, car il m’importait peu de traduire mon émotion en mots : avais-je besoin de donner dans le pauvre langage des hommes un équivalent forcément fragmentaire de ce qui était ma vie même ? Je devais à Marthe cette sensibilité exacerbée mais je ne m’en souvenais pas toujours. Tel était parfois mon éblouissement qu’il m’arrivait d’oublier la jeune fille. Elle se trouvait à mes côtés et je ne la voyais plus, trop occupé de cette joie étouffante. Seul existait pour moi le rythme ininterrompu de mon amour. C’était dans mon corps tout entier comme de sourds grondements ; des forces mystérieuses se trouvaient libérées qui me faisait pressentir une réalité où il n’y avait plus rien d’humain. Comme ce déchaînement trop romantique me ressemblait peu ! Comme il m’emmenait loin de celle qui l’avait provoqué ! Combien la pauvre enfant était dépassée par la violence de la passion dont elle était responsable ! Et pourtant, c’était bien elle, Marthe, qui par sa seule présence transformait l’univers ; de même que c’était moi, d’habitude si réservé, qui me laissais aller à ces désordres sentimentaux ! Lorsque mon cœur, emporté, avait presque perdu le souvenir de la jeune fille, un instant d’angoisse me la rappelait soudain. Je me souviens d’un soir de février … Elle était partie pour les environs de Vendôme où habitait sa grand-mère. J’avais passé sans trop de mal la première journée de solitude : aux approches du soir, je m’étais attardé à ma fenêtre qui domine Paris ; il m’avait semblé deviner une odeur nouvelle dans l’air glacé, comme le parfum d’un proche printemps. Et, tout à coup, l’absence de Marthe m’avait désespéré. Je me revois, fixant ce point de l’horizon où devait être Vendôme ; et une émotion poignante s’emparait de moi ; c’était beau, ce coin immense du firmament qu’emplissait une seule présence ! Une jeune fille suffisait à donner toute leur signification à ce ciel, à ces astres … Je ne prêtais nulle attention à ce qui n’était pas Marthe, négligeais mon travail, ne présentais à mes amis qu’un visage mort, et ma distraction éloignait de moi mes parents qui ne reconnaissait plus leur fils en cet étranger rêveur. Rien ne semblait plus avoir d’importance pour moi : j’eusse pu considérer avec indifférence maints cataclysmes épouvantables, assister sans m’émouvoir aux pires bouleversements : mais je devenais plus sensible dès que mon cœur entrait en jeu, et ce fut un incident minime qui vint pour la première fois me tirer de ma quiétude.
Dans les jardins illuminés de Mme Deshorly, par cette belle nuit d’été, sur ce banc où Marthe et moi nous étions réfugiés, un geste insignifiant par lui-même vint, on se le rappelle, me faire pressentir la fragilité de l’amour qui nous avait tenu si longtemps l’un près de l’autre, sages et réservés. Ce fut soudain la certitude que mon sentiment venait de perdre ce qui le distinguait des amours banales et qu’il devenait aussi vulnérable qu’elles. Je n’avais pas su me rendre digne de la faveur unique dont j’avais été l’objet. Mon aventure serait désormais aussi vulgaire que celles que j’avais connues autrefois, aussi incertaine qu’elles et plus encore, peut-être, vouée à une fin malheureuse. Marthe, inconsciente, riait, et cette joie qui, hélas n’était pas factice (car la jeune fille n’avait rien compris) m’exaspérait, moi dont les tristes accordéons eux-mêmes ne pouvaient adoucir le chagrin Ce fut une brève révélation dont je perdis presque aussitôt tout souvenir. Lorsque je revis Marthe le lendemain, à une exposition du Petit-Palais où nous avions convenu de nous retrouver depuis longtemps déjà, je ne fis à la soirée de la veille aucune allusion, sans doute parce que j’avais déjà oublié ce pressentiment d’un soir, ce signe obscur qui m’avait un moment bouleversé au cours du bal. Rien dans notre attitude ne nous parut changé ; mais, à notre insu, elle différa tout de même de ce qu’elle avait été jusqu’à ce jour. Je considérais la jeune fille avec une tendresse inaccoutumée, et elle se montrait aussi avec moi plus douce et plus prévenante que d’habitude. Nous allions côte à côte sans rien voir des tableaux exposés. J’avais envie de parler, de dire n’importe quoi pour me délivrer de cette oppression. Mais, de son regard, Marthe m’imposait le silence. Je la revis dès lors si souvent qu’il ne me fut bientôt plus possible d’ignorer les insensibles transformations de mon amour. J’éprouvais encore les sentiments excessifs que j’avais connus au début ; ma passion ne s’était guère tempérée ; mais elle était devenue moins égoïste. Il ne me suffisait plus de rester des jours entiers en contemplation de mon cœur pour goûter cette joie parfaite à laquelle j’aspirais. J’avais besoin maintenant de la présence continuelle de Marthe, et celle-ci elle-même ne me satisfaisait pas toujours. Jusque-là j’avais aimé la jeune fille sans presque la regarder, ayant prêté moins d’attention à l’objet de mon amour qu’à cet amour même. Ce visage ravissant m’avait plus touché par ce qu’il était capable de me suggérer que par sa splendeur propre. Je n’avais jamais considéré Marthe comme étant distincte de l’amour qu’elle me portait et n’avais pas compris (ce qui m’avait préservé de toute jalousie) que les autres êtres la voyaient et qu’elle était mêlée à leur vie. Je ne lui avais attribué que cette existence qu’elle devait à mon amour : entre sa présence continuelle en moi et sa personnalité, j’avais peu fait de différence, comme si elle n’eût pas été vivante ailleurs que dans mon cœur. Et tout à coup, à la suite de l’incident du bal Deshorly, je découvrais une Marthe presque inconnue qui agissait, parlait, se trouvait mêlée à des aventures multiples, entraînée dans une vie dont je ne connaissais qu’un des divers aspects, le principal assurément, mais non pas le seul. Je m’avisais aussi de ce que ses pensées me demeuraient également étrangères. Marthe promenait à travers le monde son beau visage et son corps sans défauts. Plusieurs hommes devaient l’admirer ; il y en avait qui l’aimaient, d’autres la suivaient dans la rue, et elle ne pouvait sans doute pas demeurer insensible à tant d’hommages. Le contentement qu’elle devait éprouver de son succès salissait l’amour qu’elle avait pour moi. Il m’eût semblé naturel que Marthe m’appartînt corps et âme. Et voilà que je ne possédais d’elle qu’une image indécise. Mais j’avais tout de même son amour ! A mes nouvelles inquiétudes répondait une plus grande conscience de mon bonheur et, pour la première fois, je m’étonnai malgré tout d’être le seul aimé. En même temps, des doutes me venaient sur cet amour dont je craignais d’être privé. Parce que les premières atteintes de la jalousie me touchaient, j’observais la jeune fille pour me persuader de sa fidélité. Mais bien qu’elle m’assurât sans cesse de son amour, je ne pouvais trouver le calme ; Marthe n’était plus jamais pour moi assez tendre ni assez affectueuse. Je l’accusais de me trahir parce que son regard parfois se détachait de moi et que je la voyais s’intéresser à des choses où je n’étais pour rien. Je découvrais alors la véritable Marthe, je la voyais enfin : c’était une belle fille, grande, sportive, mais si détachée de toute intellectualité qu’elle m’apparaissait souvent bien éloignée de moi. Cet accord du début, où nos vies étaient si mêlées l’une à l’autre, n’était plus possible maintenant que la musique d’un phonographe et le silence ne nous suffisaient plus. Et, comme nous fuyions soudain Catherine autant qu’il était possible, rien ne venait plus nous distraire de nous-mêmes. J’étais choqué de la plupart des goûts de la jeune fille ; elle aimait ce que j’avais toujours détesté, ignorait mes livres préférés, adorait des auteurs que je n’avais jamais pu supporter. Elle avait pour les sports une prédilection marquée et j’étais atterré de la voir admirer une espèce d’hommes que je n’avais jamais pu souffrir. Pourquoi m’avait-elle choisi, moi qui n’entendais rien au tennis et que les matchs de hockey sur glace laissaient indifférent ? Et, comme je craignais qu’elle ne s’aperçût enfin de son erreur et ne m’abandonnât, je lui faisais des concessions, accordais que, moi aussi, je me passionnais pour le golf et que j’attendais avec émotion le résultat de la prochaine coupe Davis. Je découvrais qu’il y avait entre nous peu de conversations possibles. Lorsque je disais quelque chose, Marthe ne m’écoutait pas et m’interrompait dès les premiers mots ; ou bien, si elle daignait attendre que j’eusse fini, elle répondait avant même d’avoir réfléchi. Elle s’étonnait visiblement des paroles qu’elle prononçait alors, mais prenait à cœur de défendre cette opinion paradoxale. Lorsqu’elle voulait bien raisonner un peu, elle m’étonnait par la finesse de ses remarques, mais alors elle m’exaspérait plus encore car nous étions toujours d’avis opposé. Même en politique où nous ne pouvions nous entendre, soit qu’elle récitât d’un bout à l’autre, comme lui appartenant en propre, les idées de son père (qui étaient elles-mêmes celles d’un journal que j’avais toujours peu aimé), soit qu’elle me livrât ses plus intimes convictions dont on ne pouvait nier l’intelligence et même, dans un certain sens, la nouveauté, mais qui me révoltait par leur cynisme. Et Marthe, à laquelle je n’avais pendant longtemps prêté aucune attention, me semblait soudain revêtue d’une sorte de prestige. Je ne pouvais m’empêcher d’admirer cet être si différent de moi et dont j’avais la chance d’être aimé. Malgré tout ce qui nous séparait, j’étais sensible à ses opinions et essayais toujours de les comprendre ; rien de ce qui la concernait ne me paraissait dépourvu d’intérêt : ses réactions les plus insignifiantes retenaient mon attention comme s’il m’eût été nécessaire, pour bien goûter mon incroyable bonheur, d’en bien comprendre tous les éléments. Je m’accommodais même de ses menus défauts ; mon amour s’en trouvait accru, ce qui m’étonnait, tant l’idée de perfection y avait été tout d’abord liée. J’étais ému de ces travers d’esprit, comme je l’eusse été si j’avais, par hasard, trouvé sur son visage quelque asymétrie ignorée. Mon amour présentait donc maintenant un autre aspect dont j’étais moi-même frappé ; mais c’était en vain que j’essayais parfois de remonter dans le passé pour y trouver l’explication de mon état présent. Je revoyais une succession monotone de faits, tous identiques, une série de réceptions sans histoire qui baignaient toutes dans la même atmosphère heureuse, si bien que je ne savais les distinguer les unes des autres. Mon amour échappait en somme à l’analyse que j’en pouvais alors faire. Le bal Deshorly ne me rappelait plus rien de particulier, et il m’était impossible de lui attribuer un souvenir précis et qu’il eût possédé en propre. Mais il me fut donné d’évoquer à nouveau les circonstances de cette soirée mémorable et d’en apprécier la portée.
Ce fut un soir des premiers jours de juillet où j’avais accompagné Marthe à la surprise-party de Laure d’Hargeois. Nous nous étions dirigés vers la fenêtre pour respirer un moment la fraîcheur nocturne. Nous nous trouvions l’un et l’autre excités par la danse, le champagne, un peu grisés. Marthe, insensiblement, se rapprocha de moi et je la sentis bientôt tout contre mon épaule. Je me rappelai soudain que la jeune fille avait eu au bal Deshorly ce même mouvement instinctif. Mais, ce soir, elle s’attardait ; on eût dit qu’elle s’appuyait à dessein pour que je ne puisse plus oublier … Je n’eus pas le courage de me dégager, mais un tel trouble m’envahit que je détournai la tête. La nuit était presque lumineuse tant il y avait d’étoiles. On devinait dans les ténèbres des jardins d’où venaient sans doute ces forts parfums de terre humide. Marthe, certainement, attendait un geste. Il n’y avait personne près de nous ; nos têtes, penchées sur le gouffre obscur, eussent pu se joindre sans qu’on le vît. Des sentiments confus m’agitaient ; j’avais peur de décevoir la jeune fille. Je n’osais bouger, mais sentais le ridicule qu’il y avait à rester plus longtemps dans cette passivité. Il fallait tenter quelque chose, répondre à l’invitation de ce corps consentant … Alors, soudain, mes lèvres effleurèrent maladroitement une joue fraîche ; et déjà je reculais, honteux d’un baiser si gauche. Je murmurai d’indistinctes paroles et m’enfuis. Ai-je même, dans mon désespoir, pris congé de Mme de Vegard ? Je ne m’en souviens plus mais me revois, marchant à grands pas dans les rues désertes. Il ne m’était d’aucun secours de savoir qu’il n’y avait pas de proportion entre ma douleur et la gravité de mon acte. La raison restait impuissante en présence de ce bouleversement de tout mon être. Si excessive était ma souffrance que j’en éprouvais une sorte de paix ; j’avais atteint l’ultime limite du tourment, et cela me rassurait d’être encore en vie, d’avoir pu résister à ce paroxysme de forces déchaînées. Je pleurai longtemps ainsi, avec des petits gémissements, des hoquets, des soupirs, et ce chagrin d’enfant déçu m’apparaissait parfois si ridicule que je souriais entre deux grimaces, me demandant si je ne me jouais pas la comédie à moi-même. Mais un nouvel excès [sic] me replongeait presque aussitôt dans cette peine extrême. Et des rues se succédaient que je ne reconnaissais pas, des rues désertes d’un quartier perdu. Une auto, parfois, troublait le calme de la ville endormie ; ses phares arrachaient à la nuit des murs aux volets clos, quelques arbres dont les feuillages demeuraient immobiles. Puis, avec le silence, renaissaient les ténèbres. L’aube me trouva dans un bistro où des maçons buvaient sans mot dire. Le patron éteignit la lumière et de l’obscurité blême surgit un chat mal éveillé qui vint dormir sur mes genoux.
Je ne touchai pas un mot à Marthe, lorsque je la revis, de notre aventure, et elle n’y fit pas non plus allusion. Je voulus oublier ce baiser timide et les heures de souffrance qui avaient suivi. La vie reprit entre nous deux comme s’il ne s’était rien passé. Cependant, il y avait à nouveau dans mes rapports avec la jeune fille quelque chose de changé. Je ressentais en sa présence une sorte de gêne qui confinait parfois à l’ennui. Il m’arrivait de suivre avec intérêt les péripéties du film que nous étions allés voir ensemble ou de choisir attentivement dans un magasin l’objet qui avait fourni un prétexte à notre promenade. Et lorsque je devais rester en tête-à-tête avec elle, une sorte de lassitude me faisait douter de mon amour. Mais une angoisse, dont la nature ne pouvait m’échapper, me saisissait dès que j’étais éloigné d’elle. C’était bien l’amour, cette émotion continue, cette inquiétude mêlée de joie, l’amour plus violent que je ne l’avais jamais éprouvé. Si je revoyais Marthe, je me sentais à nouveau un peu détaché et oubliais jusqu’à mes plus récentes anxiétés, ne pouvant admettre qu’il fût possible de tant souffrir de l’absence d’une femme dont je trouvais le visage si insignifiant lorsque je pouvais la revoir. Cette nouvelle forme de mon amour m’apportait un surcroît d’émotion ; car il me fallait endurer tour à tour les souffrances de l’éloignement puis celles d’une déception sans cesse renouvelée et qui, chaque fois, m’étonnait davantage. Lorsque je n’avais pas Marthe près de moi, j’étais saisi d’un désir violent de la revoir et la pensée qu’elle pût mener une existence à laquelle je n’eusse point part me torturait. Ce sentiment n’était pas nouveau pour moi, mais je m’en sentais honteux dès que la jeune fille se retrouvait à mes côtés, non pas que je voulusse réprimer un mouvement du cœur en somme assez naturel, mais parce qu’il me semblait humiliant d’être jaloux d’une femme à laquelle je croyais soudain si peu tenir. Devant Marthe, je supportais parfois l’idée de ne plus l’aimer ; je ne pouvais par contre endurer la pense qu’elle pût, de son côté, cesser de tenir à moi. J’entrevoyais très bien, en sa présence, la possibilité de me détacher d’elle (comment n’aurais-je pas accueilli avec joie un projet dont la réalisation m’eût délivré de mes angoisses sans fin !) mais n’envisageais cette émancipation que si Marthe continuait de m’aimer et de souffrir par ma faute. Si je concevais d’aventure des doutes sur ses sentiments, mon amour redevenait passionné, ces craintes inopinées ayant sur moi le même effet que l’absence : la jeune fille me semblait à nouveau indispensable à ma vie et je ne pouvais plus concevoir une existence où elle ne fût point mêlée. Je n’avais jamais autant chéri Marthe qu’à cette époque où je croyais en mon pouvoir de l’abandonner. Si mouvementée fut alors ma vie sentimentale que j’eus moins encore qu’auparavant la possibilité de voir clair en moi. A force de me poser des questions sur l’existence d’un amour dont je ne sentais que trop l’action continue, je ne pouvais plus démêler la nature des mouvements contraires dont je me voyais agité. Il nous restait vingt jours à passer à Paris, car nous devions partir dès le début d’août pour Gavarnie où nos parents (soudain devenus inséparables) avaient loué ensemble une villa. Et je connaissais, en attendant, ces mêmes variations brutales selon que Marthe se trouvait ou non près de moi. J’avais d’abord voulu oublier ce qui m’avait été révélé à la réception de Laure d’Hargeois. Mais je dus à ce timide baiser, dont j’étais tour à tour honteux et fier, d’avoir de mon amour une nouvelle conception à laquelle je finis par m’abandonner presque sans résistance. Lorsque j’étais éloigné de la jeune fille me tourmentait le même désir qu’autrefois, mais je lui donnais un autre sens et ne cherchais plus à me dissimuler la nature de cet élan de tout mon être qui me poussait vers l’absente. Des pensées impures m’assaillaient ; il m’arrivait de me délecter d’images sensuelles et j’allais parfois jusqu’à espérer que se réaliseraient les rêves dont je goûtais la trouble saveur. Il suffisait de la présence de Marthe, de son visage candide, de ses yeux attachés aux miens pour me faire oublier mes désirs récents. Je n’avais même pas à les renier : ils n’étaient plus concevables, et seul demeurait cet amour fait de vénération et de respect. Mais survenait à nouveau la séparation : elle devait durer parfois quelques heures à peine, c’était encore plus que je n’en pouvais supporter. Mon imagination me faisait entrevoir des trahisons d’autant plus intolérables, me semblait-il, que Marthe elle-même n’en avait peut-être pas conscience : et pourtant, cette partie de sa vie que je ne connaissais pas, où elle éprouvait des joies dont je n’étais pas la cause, elle m’en frustrait de façon injuste ! Et un autre sujet de tourment s’emparait de mon esprit : mon désir devenait soudain si excessif que des images forgées de toutes pièces ne pouvaient plus le contenter. Il me fallait faire appel à quelque fait réel dont j’avais conservé en moi le goût équivoque. Je me souvenais alors de l’étreinte du bal Deshorly, de ce geste instinctif de Marthe, un soir, sur le balcon, et surtout du baiser qui avait suivi. Je m’en voulais de n’avoir pas su profiter de l’occasion ; ma timidité me semblait incompréhensible et je décidais très sérieusement de ne plus me laisser abattre par d’inutiles scrupules : embrasser Marthe, la belle affaire ! Que signifiait cette réserve pudique que nous avions toujours gardée ? Nous avions fait l’un et l’autre, jusqu’à ce jour, bien de l’embarras ! Quel illogisme n’avions-nous pas montré en nous aimant sans permettre à notre passion de se manifester ! Nous nous étions mutuellement dupés dès le début et avions feint d’ignorer ce qui, dans notre amour, ne cadrait pas avec l’idée préconçue que nous nous en étions faits [sic]. Pourtant, je savais de longue date ce qu’était l’amour, quel était son aboutissement naturel, son charme le plus grand… Pourquoi donc avais-je décidé en présence de cette jeune fille qu’il s’agissait d’une expérience nouvelle, d’un univers inconnu où la passion avait perdu toute attache charnelle ? Oubliant ce que notre aventure avait réellement présenté d’unique, la pureté miraculeuse qui m’avait transformé, je remontais dans le passé pour y trouver une confirmation du point de vue nouveau où je me mettais. Et à peine avais-je besoin d’interpréter, les faits parlaient d’eux-mêmes. Oui, j’avais été dupe ; mon amour s’était présenté dès l’abord comme tout amour, voué à la même fin normale. Je comprenais que je n’avais pas su expliquer l’émotion ressentie en voyant Mlle de Vegard pour la première fois, au bal de Mme Dréan. L’amour, tout de suite, avait faussé mon jugement et je m’étais complu à suivre le thème charmant où m’entraînait une imagination abusée. (Mais, bien plutôt, n’étais-ce pas maintenant que je brodais sur la réalité et me berçais de rêves, puisque je négligeais soudain tout ce qui rappelait l’enchantement si chaste des premiers temps pour ne plus retenir que les détails troubles ?) Mon désir présent me faisait évoquer la voix rauque de Marthe, ce soir de décembre où je l’avais connue, cette voix dont l’âpreté jurait avec le regard candide qui l’accompagnait. Il me rendait à nouveau présent ce visage bouleversé où je guettais chacun de ces tressaillements que je me plaisais à provoquer d’un regard ou d’un mot. La naïveté de l’expression de la jeune fille et cette émotion inaccoutumée où je la voyais, avaient pour moi bien du charme et j’aimais peut-être dans cette enfant encore préservée de toute souillure l’impureté que je faisais naître en elle. Et je continuais ainsi à repasser en moi-même ces faits que j’avais considérés jusque-là sous un tout autre jour. Il m’apparaissait qu’il s’était à peine écoulé quarante-huit heures depuis le bal Dréan, que j’avais souffert déjà de l’absence de Mlle de Vegard d’une façon toute physique. Ne pouvais-je pas enfin donner toute sa signification à cette promenade sur les quais où, pour la première fois, m’avait abandonné la joie éprouvée jusque-là ? Je me savais aimé, pourtant, et j’aimais moi-même : cela eût dû suffire à un très chaste amour ; mais je n’avais pu me contenter d’une telle satisfaction. Il m’avait fallu déjà autre chose : les traits de la jeune fille me fuyaient, et c’étaient eux que je regrettais ; j’aurais voulu pouvoir les admirer encore, les couver du regard, j’aurais aimé les posséder, mêlés à ma chair même. Mlle de Vegard, dont je n’avais plus revu le visage, m’était apparue soudain si lointaine, si détachée de moi, que la souffrance m’avait jeté contre le parapet. Et j’aurais dû reconnaître déjà l’avènement de la jalousie : j’aimais un être libre de sa pensée et de ses gestes et qui me demeurerait toujours aussi étranger que l’était ce vagabond endormi sur la berge du fleuve. Et le lendemain, ç’avait été cette détresse dans le salon ténébreux, ce phonographe criard qui exaspérait ma douleur. Et la même jalousie m’avait étouffé : Mlle de Vegard ne cherchait pas à me revoir, elle m’avait oublié pour quelque gigolo dont elle était peut-être amoureuse depuis longtemps et elle ne m’avait remarqué au bal Dréan que pour rire de ma suffisance naïve… Alors, mon orgueil avait cédé, je m’étais résolu à ce geste humiliant : téléphoner à Jean-Louis, publier mon impatience, avouer que celui qui faisait attendre et se jouait d’un désir suppliant ce n’était plus moi, plus moi qui menais le jeu, mais une femme ! Le même soir, rassuré d’avoir enfin un moyen de joindre Mlle de Vegard, je m’étais rendu dans ce cabaret de Montmartre dans l’espoir soudain de tromper mon désir. Et à mon désespoir subit, j’avais donné une explication propre à me faire illusion – car, autrement, mon beau rêve se fut écroulé d’un pur et chaste amour ! Mais je voyais bien, maintenant, que la curiosité exaspérante de Michelle ne m’avait pas, au fond, étonné : cette nuit-là, déjà, seule existait à mes yeux cette jeune fille dont j’avais senti l’absence jusque dans ma chair, et des personnes indifférentes s’étaient escrimées à me vouloir distraire de moi-même ! Je comprenais maintenant d’où était venue ma fureur : je n’avais brusquement plus compris ce que j’étais allé chercher dans ce cabaret ; je découvrais que j’avais longtemps espéré y surprendre le secret d’oublier une vie décevante. Et si l’inutilité de mes efforts passés pour trouver le bonheur par des moyens aussi artificiels m’avaient confondu, c’était parce que ce bonheur, j’en possédais enfin le principe : il était certes encore mêlé de bien des angoisses, entaché de souffrance, mais j’en sentais enfin la présence dans mon corps. Mlle de Vegard m’avait apporté des inquiétudes nouvelles ; parce qu’elle était entrée dans ma vie, je ne connaîtrais plus de longtemps la paix ; mais je lui devais cette émotion continue, cette brûlure de ma chair qui me donnait, dans une joie accompagnée de douleur, le pressentiment d’un monde invisible, bien que tout proche, et dont j’espérais vaguement connaître bientôt, grâce à elle, la merveille. (Grâce à elle ! Là devait être le drame !) Mais je n’avais pas su me montrer tolérant : devant ces pantins qui dansaient avec application, j’eusse dû sourire, comme sourit des vains plaisirs du siècle l’âme gagnée à Dieu ; j’eusse dû avoir ce détachement plein d’indulgence et de triste ironie de l’homme revenu de tels égarements ; car j’avais disposé, comme ces saintes personnes, d’un point de comparaison : un sentiment transcendant, par sa seule présence, annihilait les pauvres distractions humaines. Mais je n’avais pas su voir clair en moi, j’avais ignoré de parti pris la nature de cet unique désir dont j’étais possédé ! Peu importait le reste puisque j’abandonnais des joies futiles pour d’autres plus chimériques encore.
Ainsi occupais-je le temps que je passais loin de Marthe à interpréter un passé où je trouvais toujours ce que j’y souhaitais voir : des preuves de la nature vulgaire de mon amour et des raisons de justifier ce désir, peut-être nouveau en moi, mais que j’éprouvais sans conteste maintenant. Je repassais donc ces souvenirs que je viens d’évoquer et bien d’autres encore. C’est ainsi, par exemple, que je n’avais aucun mal à trouver des symptômes de mon état présent dans la tristesse qui m’avait saisi après le premier coup de téléphone de Mlle de Vegard : j’aurais aimé être invité seul et non pas en compagnie d’amis sans doute bien peu intimes puisque j’étais compté parmi eux, moi que Marthe connaissait à peine. Et ma jalousie m’avait tellement aveuglé que j’en étais venu à croire que si la jeune fille m’eût tant soit peu aimé, elle eût dû me convier séparément, moi qu’elle n’avait encore fait qu’entrevoir dans un bal ! J’avais frémi d’être rangé au nombre de connaissances indifférentes. Pouvais-je me trouver encore abusé sur l’émotion qui nous avait saisis en même temps, Marthe et moi, pendant que M. de Vegard parlait de son amitié pour mon père ? Lorsque j’avais pris congé de la jeune fille ce jour-là, j’eusse dû reconnaître le désir dans cette fièvre naissante, qui avait peu à peu répandu dans ma chair une chaleur insupportable. Les courtes secondes de laisser-aller, au bal Deshorly, puis le baiser donné chez Mlle d’Hargeois, ne pouvaient dès lors plus m’étonner ; il m’avait été révélé de façon claire ce que je connaissais obscurément depuis plusieurs mois déjà. J’avais voulu ignorer ces avertissements répétés de ma chair, mais on ne peut indéfiniment faire violence à la nature et l’heure était venue où il m’était devenu impossible de demeurer abusé. Du moins le croyais-je, parce que Marthe n’était pas là ; mais il fallait tout remettre en question dès que j’avais devant moi son visage confiant, aux yeux étonnés, à l’innocent sourire. Il me suffisait alors, pour rougir aussitôt, d’évoquer ce baiser dont j’avais osé, un soir, effleurer sa joue : ce n’avait été qu’un essai maladroit et, mon audace m’ayant effrayé, je m’étais montré aussi hésitant qu’un adolescent sans expérience. Certes, mes lèvres ne s’étaient pas attardées, mais elles n’en avaient pas moins touché la délicate figure et, si elles n’avaient pas saisi cette bouche entr’ouverte, c’était seulement qu’elle ne l’avait pas rencontrée dès l’abord. Mon geste m’était apparu insensé au moment même où je le tenais : affolé de ma hardiesse j’avais alors donné un baiser au hasard pour en finir au plus vite. Et, à la vue de cet être auprès duquel je n’osais faire un mouvement, tant une beauté si étrange me semblait fragile, le souvenir de cet acte que je n’avais pas hésité à accomplir me remplissait d’effroi. Le miracle, heureusement, survivait à cette profanation puisque je retrouvais auprès de Marthe le même bonheur poignant. Je pressentais combien notre amour menacé exigeait de soin et de prudence : après tant d’atteintes graves, un mot pouvait suffire à interrompre l’enchantement. Je craignais surtout une intervention maladroite de Marthe car, si elle venait à faire allusion au bal Deshorly ou à notre baiser d’un soir, tout s’effondrerait sans doute. Je m’efforçais de prévenir le danger en maintenant la conversation sur un terrain banal pour écarter de la jeune fille tout ce qui pourrait lui faire évoquer les circonstances où nous nous étions montrés si légers. Lors de ces journées de juillet, qui furent si chaudes cette année-là et où je suivais Marthe dans les multiples courses qu’exigeait son proche départ, je ne songeais plus à l’histoire de notre amour afin d’y découvrir une explication de mon état présent mais je retenais de mes expériences les faits capables de m’être maintenant de quelque utilité. Je tirais un enseignement de ces hésitations passées ; elles m’apprenaient ce qu’il fallait désormais éviter, ce qu’on pouvait tenter sans crainte. Bien que très inquiet, la plupart du temps, sur les suites de mes écarts, j’espérais tout de même parfois que ces épreuves malheureuses avaient fortifié mon amour sans l’atteindre. Cette pensée rassurante me venait en général le soir, à la fin de ces après-midi éreintantes. Nous finissions souvent la journée dans une pâtisserie des Champs-Élysées, puis marchions un peu, malgré notre fatigue, pour goûter la fraîcheur nouvelle. La nuit était proche, un peu de vent se levait, arrachant aux feuillages poussiéreux une odeur de sous-bois. L’arête fauve de l’obélisque coupait en deux le Louvre, immatériel dans la lumière du couchant, et sa silhouette effritée se détachait sur le ciel d’un bleu laiteux. Alors, nous nous taisions, Marthe et moi, attentifs à la douceur de ces soirées qui répondaient si bien au mystère de nos âmes. Et pendant que nous traversions la place de la Concorde, déjà pleine d’ombre, je sentais naître en moi cet espoir réconfortant : mes égarements passés m’avaient donné une nouvelle conscience de mon bonheur sans lui porter d’atteintes durables ; rien de ce que j’avais eu la bêtise de penser ou de faire ne présentait plus d’importance, n’en avait pu jamais avoir… J’étais alors soulevé d’une telle reconnaissance que je tentais de faire partager à Marthe la gratitude sans objet dont j’avais le cœur serré. Mais cette imprudence de lui rappeler un passé qu’il eût été préférable d’oublier ne servait à rien ; elle n’avait rien remarqué d’inquiétant, ni de trouble, elle avait passé près du danger sans le voir. Mais, à nouveau, elle me quittait : dans cet amour soudain accru, je ne distinguais d’abord rien que je n’eusse déjà éprouvé auprès d’elle. Je ne m’inquiétais pas : c’était les mêmes sentiments, à peine rendus plus passionnés par l’absence. Mais, peu à peu, cette émotion prenait une autre forme. C’était un désir bouleversant, un appel que je surprenais enfin ; Marthe l’avait poussé lorsqu’elle était à mes côtés et il me parvenait seulement. Ma chair alertée brûlait de répondre, mais il ne me restait que de pleurer les occasions perdues. De tels regrets s’emparaient de moi qu’il me fallait trouver à tout prix dans mon aventure des souvenirs qui pussent me rasséréner : ces mêmes circonstances que je ne me rappelais pas sans répulsion en présence de Marthe, je m’y attachais maintenant et en goûtais l’impur parfum. J’évoquais à nouveau ces étreintes inavouées, le baiser maladroit, et cherchais un sens à des regards où je n’avais encore découvert rien de suspect. J’eusse pu longtemps passer ainsi par les mêmes alternatives et connaître sans fin ces aspects contradictoires de ma passion sans le changement qui survint dans notre existence.
Nos parents avaient loué à frais communs une villa proche de Gavarnie. J’avais attendu avec impatience ce séjour qui s’annonçait merveilleux : Marthe, tout le temps, serait près de moi, la nuit elle-même ne nous séparerait que par une mince cloison à travers laquelle je pourrais peut-être percevoir la rumeur de la vie bien-aimée, et nos existences deviendraient si mêlées l’une à l’autre que nous échapperions désormais à des tourments, rendus seuls possibles jusque-là par des séparations trop fréquentes … Je revois la petite maison un peu éloignée du village et qu’emplissait le gros rire de M. de Vegard. Dès le premier jour, une odeur d’huile de lin s’était ajoutée au parfum des boiseries. Le peintre s’exclamait sur la transparence de l’atmosphère, s’émerveillait de la couleur des sommets, de ces tons si vifs sous le soleil et dont les rapports créaient d’étranges formes. Il répétait souvent : « Les montagnes n’ont jamais eu leur peintre ! » et sa voix, alors, devenait triste comme s’il n’eût pas espéré pouvoir rendre non plus le charme de ces contrées. Le soir, les demi-teintes et les profondeurs des ombres le confondaient plus encore, et mon père évoquait pour moi des souvenirs d’enfance que lui rendaient présents ce murmure indéfini du torrent et les sonnailles un peu étouffées de quelque troupeau perdu. Marthe voulait faire des ascensions ; elle avait porté de Paris un équipement complet d’alpiniste et j’entends encore la voix inquiète de sa mère : « Tu commenceras par le Piméné, sans entraînement ce sera déjà bien beau si tu termines l’excursion ! » Et la jeune fille haussait les épaules, tandis que M. de Vegard regardait sa femme avec ironie. Des senteurs d’eaux vives entraient par la fenêtre ouverte ; le dernier car enveloppait de poussière quelques ânes, immobiles le long de la route. La nuit tombait sans que l’air perdît rien de sa pureté, et la première étoile brillait dans un ciel où le jour s’attardait. C’était sans courage que j’accompagnais la jeune fille dans ses ascensions. Je la suivais par habitude et de peur de manquer l’occasion d’un nouveau bonheur. Elle grimpait avec fougue, s’impatientant de voir le guide si lent, et je regardais cette fille joyeuse et bien musclée qui se moquait de ma paresse en attachant sur moi un regard dont j’étais épouvanté, tant j’y pouvais lire d’adoration. L’ennui où je me trouvais me rendait sévère et j’en voulais à Marthe de cette lassitude qui ne me quittait pas : je ne trouvais plus goût à rien, me sentait incapable d’éprouver la moindre joie. Diminué intellectuellement depuis le jour où j’avais rencontre Mlle de Vegard, je l’étais maintenant jusque dans ma faculté de sentir. L’existence m’apparaissait sans couleur ni gaieté tandis que, si Marthe n’avait point été là (car j’en étais à faire de tels souhaits), j’aurais pu lire et partager avec Adolphe de Vegard ces joies profondes où je le voyais (comme si j’eusse pu être avec le peintre sans me trouver en même temps en compagnie de sa fille !). Si Marthe n’avait pas été là, les choses ne se seraient pas aussi bien passées et j’aurais dû le deviner. Nul doute, en effet, qu’il lui eût suffi de s’éloigner de moi pour que sa présence m’apparût nécessaire et, avant son retour, intolérable toute occupation ; quelques jours d’absence m’auraient aussitôt rendu l’être aimé plus cher qu’aux premiers jours en m’apprenant que je ne m’en pouvais dispenser. Je n’étais pas incapable d’amour mais seulement de conserver le même rythme exténuant ; car nous avions été si loin dans l’exaltation sentimentale que c’était ne plus aimer que de se montrer un peu moins enthousiaste. Il fallait garder le ton : la moindre défaillance serait funeste à une passion qui s’achèverait alors que se briserait son élan. Je m’avisai ainsi peu à peu que mon amour s’usait à s’exercer sans interruption et me proposai de ne rien faire qui le pût rendre à la vie. En effet, après avoir subi quelques jours mon étrange tristesse sans essayer de réagir d’une façon ou d’une autre, j’entrevoyais maintenant le profit que j’en pouvais tirer. Il m’eût été facile de lutter contre ce détachement temporaire mais je trouvais préférable de tenter de mettre fin à un sentiment dont je ne pouvais plus ignorer l’inanité et que mon indifférence soudaine rendait plus fragile. Je n’aurais pas connu cette fatigue du cœur si j’avais pu attendre de l’avenir une issue quelconque ; mais il devenait lassant d’aimer et de souffrir sans l’espoir d’un dénouement meilleur. Marthe et moi avions atteint le but dès l’abord et il ne pouvait plus rien se passer entre nous : j’avais, pour ma part, épuisé depuis longtemps toutes les ressources de notre amour à qui j’avais demandé aussitôt tout ce qu’il ne pourrait jamais donner de bonheur. Ma passion déprimante n’était guère variée ; il ne fallait plus espérer maintenant la moindre révélation. Quel geste nouveau pouvait venir égayer nos rapports ? Marthe était une jeune fille de dix-sept ans et elle ne pouvait devenir ma femme avant de nombreuses années : j’avais devant moi deux ans de service militaire, et ces longues études, qui devaient m’amener au Grand Concours et nécessiter plusieurs séjours à l’étranger, étaient à peine commencées. D’autre part, je ne pouvais attendre, ou plutôt, c’était pour moi une obligation d’assouvir cette avidité de ma chair. Mon amour ne pouvait plus durer qu’à ce prix : autrement je n’avais plus qu’à fuir, à oublier ; car les douleurs de l’absence ne pouvaient être aussi pénibles que l’ennui que je devais à mon désir refoulé. Sentant obscurément qu’il n’y avait rien à espérer, je perdais courage : cet amour que je savais impossible, je me défendais d’y accorder de l’importance pour n’en pas trop souffrir. Marthe, peu à peu, me devenait indifférente parce qu’elle était inaccessible. Je m’ennuyais à ses côtés car j’éloignais de ma pensée tout ce qui eût pu m’attacher à elle de nouveau. Il n’y avait plus de délai concevable : j’avais patienté au delà de mes forces. Comme j’avais eu conscience de cette attente au moment même où il me devenait impossible de tenir davantage, j’étais pris au dépourvu : il s’agissait de trouver une solution sur l’heure à un problème dont je n’avais soupçonné l’existence qu’à l’instant où il m’avait fallu en résoudre les difficultés. Car je n’avais jamais cherché à m’expliquer les désirs dont j’étais hanté depuis si longtemps : je m’étais tour à tour laissé aller à leurs suggestions et rebellé contre eux sans tenter de concilier cette exigence sans cesse accrue de ma chair avec les conditions de mon amour. Et voilà que le geste indispensable devait être différé longtemps encore, jusqu’à ce jour lointain où la jeune fille eût pu m’épouser. Nul autre remède ne s’offrait et le seul auquel je pus prétendre m’était défendu par les circonstances. Demander la main de Marthe, à vingt-deux ans, sans situation, avec la perspective de plusieurs années de séparation (même si je renonçais à mes projets d’avenir) : ce n’était pas possible. Il était, d’autre part, absolument inconcevable que je fisse ma maîtresse de Marthe ; je ne m’étais du reste jamais arrêté à cette pensée que pour la rejeter aussitôt. La question ne se posait pas en présence de cette petite fille de dix-sept ans, de l’amie de ma jeune sœur, de l’enfant de ce cher Adolphe de Vegard pour lequel j’avais — jointe à une grande admiration — une si respectueuse amitié. Mon drame avait été de souhaiter obscurément ce bonheur impossible, sans pourtant réaliser un désir contre lequel j’aurais pu mieux lutter s’il eût été plus clair. Après les premiers mois de notre tendre idylle, j’avais senti se préciser en moi ce désir qui seul m’avait peu à peu tenu lieu d’amour. L’attitude de Marthe, les mouvements de tout son être vers moi m’avaient ouvert les yeux sur ma propre faim ; mais je n’avais pas compris qu’elle menaçait mon sentiment dans son existence même. La très pure passion à laquelle j’avais trouvé de prime abord tant de charme ne m’avait plus laissé que dans une insatisfaction perpétuelle. Il m’avait fallu ce séjour à Gavarnie pour prendre conscience de la réalité. Je concevais, pendant que je suivais Marthe dans ses ascensions fatigantes, que notre amour, dont je ne pouvais plus rien attendre depuis longtemps, avait pu se maintenir à Paris parce que des séparations continuelles venaient me stimuler : éloigné de l’être aimé, je souhaitais le revoir et ces désirs renouvelés excluaient toute monotonie. Mais à peine l’avais-je revue que de cette violence il ne subsistait rien. Je savais maintenant pourquoi ; si, en son absence, j’avais évoqué la femme, j’avais devant moi, lorsque je la retrouvais, une jeune fille inaccessible et j’éliminais automatiquement toute pensée trouble. Grâce à ces courtes absences – à la suite desquelles je retrouvais toujours Marthe (mais jamais assez longtemps pour que je puisse éprouver quelque ennui) – je passais par des états de dépression puis d’excitation qui me maintenaient dans une anxiété bien propre à perpétuer mon amour en me dissimulant son inanité sous une agitation factice. Mais, à Gavarnie, il n’en était plus de même ; les journées se succédaient sans que rien ne vînt nous séparer. Je voyais Marthe du matin au soir, j’étais obsédé de la monotonie de mes gestes, de mes paroles, sans pouvoir les égayer selon mon désir. Rien ne pouvait plus maintenant se passer entre nous ; du moins en étais-je persuadé. Mais la jeune fille, plus inexpérimentée que moi, semblait encore garder ses illusions. Pour elle, il est vrai, une fin mystérieuse existait vers laquelle allait notre amour qui lui en ferait, croyait-elle, connaître un jour la merveille. Elle se souvenait, sans doute, de ce baiser qui lui avait fait entrevoir un monde dont elle connaissait l’existence sans en avoir encore approché. Et comme rien n’est plus près de l’instinct qu’une jeune fille naïve, elle se laissait aller avec confiance et bien sûre que je saurais la préserver de tout danger. Marthe, plus âgée, se serait détaché de moi, et pour les mêmes raisons, au moment précis où je l’abandonnais. Mais elle allait vers l’inconnu ; aussi continuait-elle de m’aimer comme au premier jour, davantage même, sa passion se fortifiant de mon indifférence nouvelle. Elle ne pouvait concevoir ma froideur et, comme je ne pouvais lui en expliquer la cause, ce qui lui eût pourtant montré la violence de mon amour, je l’assurais sans cesse de cet amour, sans autre explication. M’eût-elle entendu si je lui avais dit que sa présence me faisait souffrir, justement parce que je l’aimais trop et qu’elle ne pouvait être à moi – que mon sentiment diminuait de force à cause de son excès même – enfin que je préférais ne plus jamais la voir qu’endurer ainsi ce supplice ? Et, sans doute, aurait-elle moins bien compris encore ce qu’il m’aurait fallu ajouter : sachant qu’elle ne pourrait pas être à moi, je m’étais peu à peu détaché d’elle jusqu’à ne plus la désirer. Pourquoi en effet se désespérer pour un bonheur impossible dont il est certain qu’il vous sera toujours refusé ? Par crainte d’inutiles douleurs, j’avais peu à peu écarté de moi toute occasion de souffrir. C’était à mon insu que j’avais ainsi travaillé à ma tranquillité future, mais j’avais si bien agi que je ne pus croire par la suite à des manœuvres conscientes. J’avais réussi à me délivrer. Cela s’était fait peu à peu, presque malgré moi. L’intelligence n’est pas seule à vouloir notre bien-être : il est une économie du cœur qui éloigne de nous des maux contre lesquels l’esprit est sans défense. Un matin nous nous mîmes en route à l’aube pour faire l’ascension de la Brèche de Roland ; après deux heures de marche, au cours desquelles je n’eus à échanger que de rares paroles, car la jeune fille bavardait avec le guide, nous fîmes halte auprès d’une source. Le soleil commençait d’être chaud ; il était bon de se reposer ainsi en mangeant les sandwiches préparés par nos mères… Je m’étendis sur l’herbe, assez verte à cet endroit, et fermai les yeux. Marthe vint me rejoindre, sans bruit, et se glissa à mes côtés. Je la sentis contre moi et le même désir que j’avais connu au bal Deshorly et chez Laure d’Hargeois m’envahit. Je n’eus pas le courage de résister, glissai mon bras sous la taille de la jeune fille… Nos visages se touchèrent presque ; Marthe murmura : — Tu m’aimes donc vraiment ? Je ne répondis qu’en serrant un peu plus mon étreinte, considérai ces yeux clos, cette bouche entr’ouverte. Je vis le guide s’éloigner discrètement et je trouvai aussitôt la force de m’arracher : — Allons, Marthe ! debout ! sinon nous n’arriverons jamais ! Je l’entendis murmurer : elle se moquait bien de l’excursion ! c’était si agréable de se reposer… Je donnai, sans l’écouter, le signal du départ. Dans la vallée, le brouillard se levait, découvrant un petit village. Un oiseau de proie faisait au-dessous de nous de grands cercles. Le guide trouva le premier edelweiss et l’offrit à Marthe… Je la regardais avec tristesse, qui marchait devant moi, tête baissée. Ne l’aimais-je donc plus ? Je venais de la désirer comme je l’aurais pu faire de n’importe quelle autre femme. Voilà où avait abouti un sentiment si pur ! Ma rencontre avec Mlle de Vegard m’avait arraché à la compagnie d’êtres souillés pour me faire éprouver une impression de fraîcheur ; après avoir connu tant de femmes pour lesquelles existaient seules les délices charnelles, j’avais trouvé une jeune fille auprès de laquelle l’amour n’avait pu présenter, en raison de l’âge de celle qui me l’avait inspiré, la même forme brutale. En voyant la seule approche de cet enfant me rendre ma délicatesse passée, je m’étais imaginé retrouver ma pureté perdue ; j’avais cru être transformé, alors qu’en réalité j’étais demeuré le même, m’adaptant seulement à de nouvelles conditions. En présence d’une femme désirée et sensible au désir, il fallait aller droit au but ; mais avec une jeune fille de dix-sept ans, l’amour ne présente plus ce franc visage. En découvrant la présence de mon affection nouvelle, j’avais été ébloui : ç’avait été comme une bouffée d’enfance, un parfum oublié, le charme du premier amour. Je n’avais connu par les femmes, dès l’adolescence, que les joies de la chair, et le sentiment dont j’étais maintenant possédé ne les avait pu impliquer. Ou, tout au moins, il n’en avait pu être question de façon immédiate. L’échéance m’ayant apparu éloignée, j’avais cru échapper au sort commun de tout amour, encore que ma chair, déjà troublée, eût dû me détromper. J’avais cru à la révélation merveilleuse d’un univers insoupçonné : parce que j’avais adopté d’instinct la seule attitude possible et qu’elle avait éloigné pour le moment toute participation physique, j’avais naïvement cru qu’il suffirait toujours de la seule présence de Marthe pour conserver intacte en moi cette félicité poignante. Mais la scène du bal Deshorly, puis ce baiser furtif, étaient venu tout gâcher de mon beau roman, sans qu’il m’eût été permis de les éviter ou même de les différer plus longtemps. J’entrevis l’existence médiocre dont Marthe m’avait tiré et où j’allais retomber. Ma passion pour cette jeune fille était sans doute une chose à jamais oubliée, et je me pris à la regretter pour la première fois. Cette mélancolie était bien la preuve que tout était passé. Et pourtant, je pris soudain la résolution de quitter Gavarnie ; il me serait facile de me faire inviter par Jean-Louis Dauvherlan. Mon départ mécontenterait mes parents qui ne pourraient, à juste titre, s’empêcher d’y voir une impolitesse pour leurs amis ; mais il était prudent de fuir. Mon amour était peut-être bien mort en moi, mais non pas le désir, ce désir que je pouvais, en le contentant, élever aussitôt à la dignité d’amour : la tentation serait trop grande… Je savais maintenant que rien n’était fini, que l’absence irriterait un sentiment qui venait de renaître et que la seule pensée d’une proche séparation me rendait à nouveau sensible. Mais je saurais ne pas céder à cette illusion nouvelle, j’en avais assez appris maintenant pour trouver le courage de fuir ce corps défendu, et ne plus l’approcher puisque aussi bien cela ne servirait jamais qu’à exaspérer ma souffrance.
Marthe allait toujours devant moi, silencieuse. Ses pieds, chaussés de gros souliers, butaient sur les pierres du sentier ; je ne voyais pas son visage mais devinais qu’elle pleurait. Il m’eût fallu, pour la consoler, lui dire quelques mots tendres, enserrer sa taille de mon bras, sentir à nouveau contre moi la douceur de ce corps charmant… Alors, me faisant une dernière fois violence, je feignis de n’avoir rien vu et rejoignis le guide d’un air dégagé.
Claude Mauriac, Paris-Malagar, juillet-septembre 1935 |
||