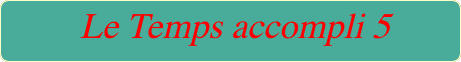|
[1994]
31 octobre 1994.– « … à l’intérieur de lui-même…» (France Culture). À l’intérieur de moi, il n’y a rien.
Paris, vendredi 18 novembre 1994. – Il y a deux ans (me dit Marie-Claude) mort de Claire. Cela me paraît si loin et si peu vraisemblable toujours…
Samedi 19 novembre 1994. – Rêvé presque chaque nuit de mon père. Lui et moi, sans âge, mais actifs dans le temps immobile.
François Mauriac rencontré quai de la Mégisserie : Est-ce qu’Olivia sera là ?
(19.XI.94). – Tant bien que mal à tâtons. Dire que je pensais appeler le T.a. 4 : Travaillez tant que vous avez la lumière. J’ai décidé, pour l’instant, de ne pas publier ce Temps accompli.
Hier, dépression totale. Même si l’état de mon œil gauche ne s’aggrave pas, le handicap est angoissant. Amélioration possible… qui sait…
Vendredi 25 novembre 1994. Minuit 25. – Dans la nuit le chien d’Arras aboie et se tait.
Ce matin, 4e laser long et pénible à l’Hôtel-Dieu.
25 décembre 1994. – Je n’ai pas gardé trace d’une heure admirable de Xavier Emmanuelli.
Noël 94. – Seule trace conservée d’une bouleversante intervention de Xavier Emmanuelli le 25 décembre, et extrait d’un programme ultérieur dans Télérama.
Dimanche 22 janvier 95 [un extrait de Télérama est collé : « 18.15 Fourvière. Humaniste et mystique. Après le superbe rendez-vous en décembre dernier sur France Inter avec Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social à Paris, c’est au tour de Radio Fourvière de mettre en lumière ce personnage éblouissant de simplicité. »]
Samedi 26, dimanche 27 décembre 1994… – Vertiges. Froid intense. En perdant mon œil droit, j’ai perdu mon équilibre physique, intellectuel et spirituel.
Samedi 3 décembre 1994. – Je n’ai plus d’ancrage dans la réalité. 21 h 50. Une disparition d’être.
Dimanche 4 décembre 1994. – Mort de Roger Stéphane.
Christine Clerc :
C’est dans un petit avion qui avait décollé du Bourget une nuit d’octobre 1989 en direction de Beyrouth que je connus Roger Stéphane. Le voyage, organisé par Daniel Rondeau et Jean-François Deniau, avait pour but de soutenir le Général Aoun, qui résistait dans son bunker aux ultimes assauts syriens. Notre fragile esquif faillit se perdre. Enfin, nous atterrîmes dans une effroyable tempête et pendant toutes ces heures, Stéphane conversait avec Claude Mauriac… de Mauriac, Gide et Cocteau – qu’il avait très bien connus. J’étais émerveillée. Ce fut sa première leçon : en toutes circonstances, l’esprit doit dominer…
(Figaro Magazine, 17 décembre 1994).
Lundi [il s’agit du dimanche] 4 décembre 1994. – Vie rétrécie. Je me désintéresse. Ne souffre pas de ne même pas ouvrir les hebdomadaires. Je décèle et peut lire avec une loupe de courts articles qui, intellectuellement, politiquement méritent l’effort de les lire.
Hier, j’ai pris cette paresse pour un début de sagesse.
(4.XII.94). – Le plus pénible est l’obscurcissement de ce qui m’entoure.
4.12.94. – Charles Juliet sur France Culture :
Descendre de plus en plus profondément en soi-même.
Dit avec le maximum de discrétion.
Moi, je suis au fond de l’abîme. Impossible de descendre plus bas. Remonter. Accepter.
4.XII.94. – Plus aucune arrière-pensée littéraire dans ces notes brutes que je ne prends plus la peine de rédiger.
Je n’ai que trop tendance à me plaindre, (Pauvre Marie-Claude…), mais, le plus souvent, sans l’avoir voulu. Réaction instinctive de qui est chaque fois surpris à neuf : « Mais je ne vois rien ! » Je vois pourtant, mais je m’habitue mal à l’insuffisance, l’imperfection, le flou de ce que je vois.
Mardi 6 décembre 1994. – Il n’y a plus personne là où je suis.
Anne W…
Usage strictement personnel de ces notes. Encore faut-il retrouver les pistes. La piste…
Je risque d’oublier tout cela. Il faut en avoir noté les éléments.
Mardi 13 décembre 1994. – Troisième chute en une dizaine de jours. Dos très douloureux.
Mardi [en réalité mercredi] 21 décembre 1994. – Radio. Tassement d’une vertèbre.
Docteur Jeanson le 22. Traitement commencé le 23 décembre. Douleur. Nuits difficiles.
25 26 décembre 1994. – Pirate sur un vol d’Air France à Alger. Délivrance par le GIGN à Marseille. Sang froid de Balladur qui a pris le risque. Pas de blessés chez les passagers.
Mardi 27 décembre 1994. – Maman, radieuse de jeunesse et de beauté, rencontrée avec mon père dans le métro. Moi, dans le bonheur de l’aimer : « Vous me manquiez tellement… »
Paris, samedi 31 décembre 1994. – A l’invitation pressante et inattendue de Nathalie, je lis chaque jour l’Evangile. Inattendue pour moi aussi. Cette exigence soudaine alors que je n’aurai jamais la foi.
31.12.94. – Tant à dire… Mais quelle fatigue, déjà. Ce (Ces) (trop !) signes de croix au cours de mes nuits, parfois.
Donné à notre président et ami Marcel Schneider, ma démission du jury Médicis. Je lui dis que physiquement et moralement ce ne serait pas honnête de persister.
[1995]
Paris, dimanche 1er janvier 1995. – Nathalie me rappelle de Lakeville, lors d’une de nos conversations téléphoniques fréquentes, qu’il y a un second lac Tibériade, à la fin de Saint Jean.
Courte embardée déjà achevée…
Janvier 1995. – Pour me donner courage, inséré ceci à Goupillières, d’un lecteur inconnu, Eric Sanning :
[lettre d’Eric Sanniez, sans date. Claude Mauriac a inséré dans son manuscrit les lettres de ses correspondants, se réservant d’en choisir des extraits lors de la publication du Temps accompli 5. Choix que lui seul pouvait faire. Nous avons pris le parti de signaler simplement les lettres à leur place d’insertion.]
Samedi 14 janvier 1995. – Reçu et lu d’un trait avec appréhension et admiration Alcyon [Arion] de Bruno…
Dimanche 15 janvier 1995. – Rêve. Ramassai photo légèrement froissée de maman très jeune et très belle. La regarde, la déchiffre avec un profond amour.
Mercredi 1er février 1995. – J’ouvre ma petite Hermès pour la première fois depuis que j’ai presque soudainement perdu mon œil droit – l’autre en principe valide, mais sous laser (cinq séances), et des difficultés de lecture accrues. Trop fatigué, déjà, pour continuer. [Le journal de ce jour est dactylographié.]
13 février 95. – José Cabanis, dont l’attentive amitié ne laisse rien échapper de ce qui, dans ses travaux, concerne Le Temps immobile, m’envoie copie de l’extrait d’une lettre de Roger Martin du Gard à Roger Stéphane (Bibliothèque du Saulchoir) au sujet du texte publié dans l’Hommage à Gide de la Nouvelle Revue Française :
… Si je m’étais douté de tout ce qui allait paraître d’articles, de commentaires, de confidences – et surtout si j’avais connu le remarquable et substantiel Journal, de Claude Mauriac, je me serais abstenu.
(Recopié et inséré ici, à Goupillières, le 4 août, pour m’encourager… toujours.)
1er mars 1995. – Arrivée de Nathalie et des deux petits garçons.
Radio. « François Mauriac et la musique ». Sublime. La glace où j’étais pris depuis des mois fond d’un coup.
Je disais ne plus rien ressentir, être desséché, et voilà… Si je voyais mieux, quel journal à écrire… Mais je ne peux plus continuer…
Récemment retourné à Goupillières, dans les dernières pages du cahier aux feuilles jaunes partiellement utilisé, cette note peu lisible du 1er mars 1995, qu’aujourd’hui, à Paris, dimanche 1er septembre 1995, je transcris tant bien que mal…
1er mars 1995. – Radio. Cassette peu audible sur François Mauriac et la musique. Quintette de Mozart et de Schubert… Festival de Salzbourg 23 août 1933. Bruno Walter ce jour-là ressuscité par la voix de François Mauriac ressuscité :
« … Entouré de tout son orchestre qu’il semble non pas diriger, avec lequel, en communion totale avec lui, il se fond. »
Mon père, un homme qui n’est plus là mais que Mozart, que Schubert rendait plus vivant, plus présent qu’il ne le fut jamais…
Inoubliable disque de la rue de la Pompe, Chopinata, au cours de la même émission. Chopin délicieusement pastiché par Wiener et Duval et découvert grâce à eux, rue de la Pompe, alors que je ne l’avais, probablement, jamais entendu, encore…
Paris, mardi 8 mars 95. – Je ne m’étais pas encore habitué à mes 80 ans que les 81 ans sont là tout près…
(8.3.95). Nocturne. « La vie de Bertrand » entra. J’appelais ainsi cette vaine recherche, depuis des années, [de] quelqu’un qui soit né le jour de la mort de mon cousin, 23 juillet 1928. Notre rencontre fut décevante. J’avais désormais tendance à l’appeler « la mort de Bertrand ».
(8.3.95). J’aimerais qu’une météo soit possible pour mon « bon œil » dans l’espoir qu’elle pourrait annoncer, un jour, la disparition des nuages.
Samedi 4 mars 1995. – Rêvé de Bertrand et de Bruno enfants, tels que je ne les ai jamais vus seuls et qu’ils viennent de m’être découverts dans Halcion [Arion].
Goupillières, nuit du 7 au 8 juillet 1995. – Nous n’échappons pas au temps. Mais le temps nous échappe.
Goupillières, samedi 8 juillet 95. – Relu pour correction définitive ch. II du T. a. 4. Fin 92 tel que je suis aujourd’hui (à l’aggravation de ma mauvaise vision près). À quoi bon un journal ? Mes réactions et tristesses sont exactement les mêmes. Près de 3 ans et le temps qui nous use et nous tue intimement [un mot non déchiffré] insaisissable de sa fuyante réalité immobile pourtant.
Goupillières, dimanche 9 juillet 1995. – Journal, 31 décembre 92 à Goupillières déjà ! alors que j’en suis resté absent, et de toutes campagnes, près d’un an !… où je revis la soirée du 31 décembre 1929 que je n’ai jamais cessé de vivre. J’ai l’impression de lire ce que je me proposais d’écrire si je me remettais, enfin, à mon journal et que, hier encore, je sentais le besoin d’évoquer comme si je n’en avais rien dit encore qui corresponde à ce que j’avais vraiment vécu cette nuit là – dernière des années 20… ce que « je croyais sauver du temps » (31.XII.92) me semble toujours à sauver, comme si elles n’avaient servi à rien les milliers de pages de mon journal et qu’il me fallait toujours redire ce qui n’a cessé de se dire en moi.
Husserl (1er janvier 1993, p. 6), « la conscience de durée de l’objet du temps… » Je crois comprendre soudain, je comprends enfin, puisque tel est mon propos désormais pour ce qui sera peut-être le tome 5 du Temps accompli.
Je voulais noter, il y a quelques jours (mais je n’arrivais pas à me remettre à mon journal) : Si entourés que nous puissions être, nous sommes tout seul. Et seul d’abord avec nous-même qui n’avons d’existence et de présence qu’illusoires ou du moins inaccessibles…
… Or redécouvrant ces pages de journal de janvier 93, je me retrouve moi qui m’étais perdu.
« Notation personnelle » à laquelle je m’intéresse enfin, puisque cette personne est là inscrite dans ces pages anciennes (pas si anciennes !). Me redécouvrant hier, comment pourrais-je douter aujourd’hui de ma présence personnelle au monde.
Goupillières, 29 août 93. – Journal démagnétisé d’un coup dans sa totalité.
Goupillières, 12 juillet 95. – … et qui était demeuré tel jusqu’à sa redécouverte dans ces pages d’il y a deux ans.
Relisant dans le manuscrit du T.a. 4 mon journal de 1993, je me retrouve en 1995, non plus épuisé, ni désespéré, mais hors du temps, dans l’exultation paisible du travail après une si longue interruption, comme aux plus beaux jours recommencés.
Goupillières, jeudi 13 juillet 1995. – La crainte de ne pouvoir y éviter de parler de ce que je suis devenu et de n’y enregistrer que des plaintes, était une des raisons de l’interruption de ce journal. Et voici que j’avais tout dit déjà et monté avec quelques coupures dans le T.a. 4 qui brusquement de nouveau m’inciterait au silence s’il n’y avait cette volonté, longtemps refoulée, d’achever avec le T.a. 4 « mon œuvre », cette œuvre-là sur le temps.
Je croyais avoir pris la décision de publier ce volume que j’avais pourtant définitivement renoncé depuis six mois, plus, peut-être, et me voici, de nouveau, dans l’indécision.
Goupillières, samedi 15 juillet 1995, 11 h 40. – Achevé avec la plus grande difficulté la lecture de mon manuscrit. Est-ce la fatigue ? Je vois de plus en plus mal et n’ai pas le courage d’écrire, même très court, un journal indispensable sur mon dernier séjour à Goupillières (août 94) avant plus d’un an d’absence.
G. Dimanche 16 juillet 1995. – Essayé de vérifier dans un volume précédent une date, peu lisible dans mon manuscrit, dont je n’étais pas sûr. La plus petite recherche qui m’aurait pris q[uel]q[ues] instants lorsque je voyais encore bien – ou pas encore trop mal – me demande maintenant de longues, longues minutes. Trop fatigué déjà, j’y renonce.
Impossible de travailler ce matin. Je voulais écrire un journal pour faire le point. En q[uel]q[ues] jours ma vue a baissé. J’étais émerveillé les premiers jours, ici, de cette révision[,] de pouvoir lire mon manuscrit. Il était temps que j’achève hier cette révision. Espérons qu’il s’agit d’une défaillance passagère. Il y aura bientôt un an que j’ai perdu mon œil droit.
Je n’arrive pas à retrouver la date exacte. Était-ce encore à Goupillières ? Je le croyais… Fatigue cérébrale plus dissuasive que cet obscurcissement. Journal de toute façon impubliable.
G. Nuit du dimanche 16. Lundi 17 juillet 95. – Journal à condensation et non plus exposition.
G. Lundi 17 juillet 1995. – Lors de mes véri[fi]cations avortées d’hier, découvert avec étonnement que près de six ans s’étaient comme on dit : écoulés, depuis mes brefs et impressionnants passages à Beyrouth. Écoulés sans que j’en aie pris la mesure. Ecroulés, alors que mon impression était celle d’un lent engloutissement. Cet ultime voyage, si impressionnant, fut la dernière manifestation, que je ne savais pas telle, d’une survivante jeunesse au sein d’une vieillesse encore active et féconde. Ce malaise au palais de Baabda me semblait si proche encore. Coup de gong qui sans que j’en prenne encore conscience marquait la fin non plus d’une reprise, mais du combat lui-même. Le temps existe certes et pourtant il n’existe pas. Aucune trace du temps que ces jalons, personnels ou historiques, observés, ressentis, enregistrés, de loin en loin, de temps à autre. Le même temps dont nous avons une connaissance continue mais une connaissance éclatée.
Ainsi contre toute espérance j’ai pu exposer, ce matin, et non pas seulement condenser, ce que j’avais en partie à dire. (Entre tant de silences que je voudrais tenter ici de rompre.)
G. Jeudi 20 juillet 1995. – Recopié plus lisiblement mes notes manuscrites de la fin 94 et des premiers mois de 95.
Je retrouve le bonheur paisible du travail matinal retrouvé après une si longue interruption (car je n’appelle pas journal ces notes hâtives et peu lisiblement griffonnées l’année dernière et au début de cette année). En un sens je ne vis plus lorsque je ne peux plus commenter ma vie, me situer dans la vie. Ce journal, enfin recommencé, me rétablit dans mon équilibre, me fait retrouver un temps pur délivré des tristesses, détresses et découragements et plongeons du quotidien.
Rythme retrouvé qui ponctue un temps non daté alors que c’est un journal quotidien que j’écris. Un temps purifié. Le temps pur de mon travail matinal de toujours. Bien plus bref, désormais, et manuscrit mais tout aussi fécond.
Grâce à un feutre très noir et non sans mal, à mon écriture grossie je me relis mieux que je ne lis.
Sans en prendre d’abord conscience, je n’ai pas ouvert un seul livre depuis que je suis ici. Cela ne m’était jamais arrivé. Je me contente (si j’ose dire !) de retrouver chaque jour à la radio, à la télévision et dans les journaux plus ou moins facilement décrypté la honte du désastre bosniaque. Effondrement de l’O.N.U., déshonneur de l’Occident, inexistence de cette Europe à laquelle nous ne cessions de vouloir croire.
Quant à notre nouveau président. Il y aurait trop à dire sur Jacques Chirac et je ne sais si j’aurai un jour le courage de le dire.
Ma raison d’être : ce journal. Sans lui, je ne suis pas.
J’ai tout de même travaillé une heure et demie ce matin !
13 h. – Le Tour de France de passage à Langon. Toujours cette impression d’être au bord d’exprimer enfin ce que l’on sait si bien et que l’on dit toujours si mal.
Je croyais avoir rompu tout lien (sauf celui du parc de Saint-Symphorien) avec ce pays – et Malagar lui-même. Émotion inattendue au nom de Bazas. Attendue déjà et éprouvée à Langon traversé par les coureurs sans que l’on en voit presque rien. Sauf, survolés par l’hélicoptère, le clocher émouvant d’une église jusqu’ici mal jugée, les piliers subsistants du pont de fer d’autrefois sur la Garonne, un peu plus loin, au tournant de la route de Malagar le long pont de pierre de mon enfance. Malagar violemment espéré, si proche mais non cadré. Rien ne passe ici de mon émotion – que j’ai préféré d’évoquer le plus vite possible, pourtant moins bien que je l’aurais fait demain où cela eût été de toute façon si insuffisant encore.
19 h. J’ai renoué avec moi-même. Le repos, soudain, est de travailler.
G. vendredi 21 juillet 1995. – D’éventuels lecteurs trouveront sans doute anodin ce qui me permet en ces derniers jours de revivre.
G. Samedi 22 juillet 1995. – Il m’a fallu plus de trente minutes pour découper et coller à sa date quelques lignes de Christine Clerc sur Roger Stéphane qui venait de se donner la mort. Toute manipulation m’est désormais si difficile et fatigante que je dois renoncer aux montages d’autrefois, heureusement rares dans les Temps accompli.
Goupillières, mardi 25 juillet 1995. – Ouvert pour la première fois mon Hermès d’ici. Les caractères semblent plus lisibles que ceux de ma machine parisienne.
Vrai journal impossible. Trop intime. [en marge de la suite, au crayon : ne pas recopier] Bruno au téléphone une fois de plus si impressionnant. Besoin soudain, impératif de parler à Jean. Il ne réagit pas à mon « Tu me manques… » si vrai, répète : « Quant à Bruno, que te dire de plus… » [Journal précédent dactylographié, suite manuscrite.]
Trop pâle. Je me relis à peine…
Journal impossible. Trop intime. Trop à dire même dans le non-personnel. Et je vois très mal en ce moment…
Inhibé, aussi, par l’inintérêt, aux yeux des tiers (à de rares exceptions près non de critiques professionnels mais de quelques lecteurs). Et aux miens. À moi-même.
Ma désaffection des derniers mois (presque un an, déjà) était justifiée.
J’étais persuadé que j’étais à jamais détaché de ma littérature. Comme d’avoir rompu tout lien sentimental avec Malagar. Et voilà que je suis, que j’étais près [de] replonger.
Journal publiable impossible lui-même parce que trop long à écrire. Obscurcissement de l’esprit, aussi.
La Bosnie, Chirac à l’Elysée, Juppé à Matignon, la Bosnie surtout et l’impuissance totale, à ce jour, de l’ONU et de l’Europe. Les dernières enclaves serbes tombent les unes après les autres. Un ultime espoir pour Sarajevo… et puis Xavier nommé Secrétaire d’Etat à l’action humanitaire. Ses interviews, son action que j’aimerais citer, qu’il serait indispensable que je cite dans le T.a. alors qu’il occupe une si grande place dans le T.i. Roman de ma vie dont il est un des personnages… Devenu Secrétaire d’État comme Rastignac…
Et Laurent, retrouvé en rêve après avoir enfin vu la veille à la T.V. son Temps Contretemps (de Ronald Harward). Il tenait tellement à ce que j’y assiste. Mais le théâtre, déjà, m’était devenu inaccessible. Pascale de Boysson admirable. Lui, semblable à lui-même. Belle pièce. Je lui dis, dans mon rêve, combien j’ai regretté de n’avoir pu le voir sur scène. Son air, alors, de fausse indifférence et de réprobation visible… Nous ne nous voyons plus. Je ne voyais plus Xavier. Sans en souffrir : ils étaient, ils sont présents, vivants en moi.
J’aurais aimé raconter d’autres rêves où m’étonnèrent l’exactitude, la précision du moindre détail physique et psychologique. Pas le courage. Et ne pas oublier que rien n’est plus embêtant que les rêves des autres.
G. Jeudi 27 juillet 1995. – À Nathalie qui prenait hier des nouvelles de mon travail, j’ai répété que j’étais de nouveau, après une courte rémission, rempli de… non pas de doute, de certitude quant à l’inintérêt, pour les autres et pour moi, de mon journal, une fois encore désenchanté à mes yeux dans sa quasi-totalité. Ce nouvel essai si consciencieux qu’il soit ne peut être sans doute qu’un échec. Je n’approche plus personne que moi qui n’intéresse personne et m’intéresse de moins en moins à ma personne plus incertaine que jamais. Plus aucun alibi. Je ne parle pas de de Gaulle ou de Foucault mais de moindres seigneurs. Restent mes petites impressions et réactions personnelles qui légitimaient autrefois mon journal, et lui donnaient sa raison d’être.
J’en ai découvert cette nuit la raison. Si vieux que je fusse déjà, j’avais un avenir. La mort, toujours présente, était une menace lointaine. De moins en moins lointaine, mais il restait un espace devant moi. Un espace de temps qui légitimait que je tienne registre de ce que je vivais. Action, pensée, réactions, rencontres, voyages même proches – et déplacement libre, liberté de mouvement, surprise de possibles amitiés nouvelles. Tout une mise en scène de ce spectacle était dès lors possible dans mon journal. Je me souciais peu de ce qu’autrui en penserait si j’en publiais de nouveau des fragments. La vie, ma vie, si peu riche qu’elle fût, avait des possibilités, sinon même des probabilités d’expansions, de jaillissements, d’éclats. Sans me faire trop d’illusions sur moi-même, je ressentais toujours ce besoin très très ancien (cinquante ans et plus, chaque année plus, du journal).
Et soudain devant moi – ce sont les mots que j’ai griffonnés cette nuit, le butoir sur la mort.
… l’expression « à mes yeux » que j’ai toujours tendu à employer, est devenue inexacte. Je n’ai plus qu’un œil (l’autre malgré tout utilisable comme le prouve ce journal manuscrit, moins lisible déjà je m’en avise soudain – mais Jean Allemand saura le décrypter). Univers rétréci autour et devant moi. En moi.
Goupillières, vendredi 28 juillet 1995. – Choc, en fin de journée, le mardi 25 juillet de l’attentat du R.E.R. de la place Saint-Michel.
Sept morts à ce jour, 84 blessés, dont onze encore dans un état grave… Trop à dire – mais je vois trop mal et ne peux continuer.
G. Dimanche 30 juillet 1995. – Jean Allemand m’a envoyé un encadré de La Croix : « Repères. Dix incontournables au choix. » Trop c’est trop, mais ce témoignage spontané, hors des habituels et conformistes célébrations ou silences des critiques me rassure, m’assure. Et d’autant plus que quelques lettres de fidèles ou d’inconnus me sont parvenues ou ont été retrouvées par hasard le même jour. Plusieurs d’entre elles célébraient le souvenir de Bertrand à l’occasion du 23 juillet (De nouveau Walter Gaeremynck) et un nouveau venu, Jacky Bertrand, qui m’écrit :
[lettre de Jacky Bertrand du 24 juillet 1995]
J’aimerais citer cette lettre dans le T. a. 5 – comme j’ai osé le faire parfois. Je l’insère ici pour que Jean Allemand la dactylographie et pour me réserver la possibilité d’en reprendre au moins quelques passages. Comme celle-ci de Louise Nepveu, fidèle lectrice canadienne :
[lettre de Louise Nepveu du 14 juin 1995]
Ou encore ceci d’un nouveau venu, Francis Lavignette, reçu le même jour que l’encadré de La Croix.
[lettre de Francis Lavignette du 23 mars 1995]
Je n’avais pas vraiment lu cette lettre d’une écriture minuscule mais Marie-Claude m’en a fait la lecture. Pour la première fois depuis la reprise de ce journal à Goupillières j’ai renoncé à n’y pas insérer ce qui ne pourrait pas nécessairement (décemment) être publié.
Cela me réconforte d’avoir intégré ces lettres. Je m’y suis résolu au moment où je venais d’en recevoir un secours. Ces lettres fussent-elles rares (mais il y a des lecteurs qui n’écrivent pas) m’apportent la preuve que je me trompe en craignant que ce journal n’intéresserait personne. J’aurai, longtemps, quelques rares fidèles…
… aussi bien le T.a. 5 risque d’être inachevé – et posthume.
[encartée la coupure de La Croix – les « dix incontournables » – avec la mention au crayon : à ne pas reproduire]
Intelligente et convaincante interview de Xavier par Catherine Nay dans Le Figaro Magazine. Jamais ministre ne fut mieux à sa place que l’actuel Secrétaire d’Etat à l’action humanitaire d’urgence.
À sa mère (enceinte…) le second fils de Nathalie, trois ans : « Tu sais maman il paraît qu’on amène parfois le bébé à la maison… »
G. Lundi 31 juillet 1995. – Rétabli les passages sautés par pudeur dans mes notes de décembre 94. Plaintes gênantes étant donné mon âge et ces atrocités dont la télévision nous accable. Mais j’ai renoncé à n’écrire, à n’insérer que ce qui paraît publiable dans le T.a. 5 ? Il sera toujours temps de faire des coupes. Si je n’ai pas été arraché au temps, à la vie.
J’ai tu jusqu’ici, à de rares exemples près, mes brèves, diverses, possibles insuffisances cérébrales dont des trous de mémoire inquiétants. Ma surdité, dont je n’ai jamais parlé, s’est aggravée. J’entends bien les informations et les débats. Mais une grande partie des dialogues (surtout féminins) m’échappe dans les films, à la TV.
Luce me rappelait que mon père attribuait ces défaillances auditives à des soudaines occultations cérébrales. J’y avais déjà pensé.
J’ai donc décidé non pas de tout dire mais d’en dire le plus possible.
Pour l’essentiel, toutefois, je compte tenir ferme la barre pour que le Temps accompli 5 se compose en quelque sorte seul. Il m’est, en effet, désormais impossible d’espérer pouvoir accomplir les choix, et divers travaux physiques indispensables à mes montages passés.
J’éprouve le besoin de le redire : quand je travaille, j’existe, je ressuscite. C’est comme une pompe réamorcée, un esprit qui se remet à battre. Ca durera ce que ça durera. Dans la mesure où cela dépend de moi je ferai l’impossible pour continuer ce journal et composer, dans le même élan, le T.a. 5.
G. Mercredi 2 août 1995. – Eu la sagesse de ne rien écrire ici, lundi. Ayant pris conscience que je risquais de dire cela (si je ne l’avais déjà fait) en glissant de ce qui était prévu pour Le Temps accompli 5 au journal d’autrefois où étaient mêlés de l’uitiisable immédiat et des pages non publiables du moins dans ce T.a. 5.
Hier encore, je souffrais de ne pas écrire un journal désormais indispensable pour moi à ma vie qu’il arrachait à la torpeur. Aussi bien n’avais-je de toute façon rien à dire. Et soudain, cette nuit, la source s’est mise de nouveau à couler.
D’où ces quelques lignes et celles qui suivent, notes prises au cours de la nuit mais surtout entre cinq et six heures du matin. Le difficile, longtemps l’impossible, est de me rendormir, de nouvelles phrases naissant toutes seules et des idées à développer. Je ne dors pas, mais je revis.
« Et on en est si près… » murmure mon père à Vémars d’une voix évasive, étouffée et triste. J’en suis là, moi aussi, j’en reprends conscience cette nuit et m’étonne de n’en plus éprouver, comme si souvent, de l’angoisse, angoisse d’ailleurs adoucie par une mystérieuse connaissance, (certitude, illusion ?). Il y a deux savoirs. L’un conscient, incontestable. L’autre inconscient mais allant de soi, tombant sous le sens, un sens inconnu, l’irrationnel l’emportant sur le rationnel. Il y a ce dont on a connaissance d’une science certaine – la mort. Et ce que l’on sait de façon obscure, un savoir autre qui l’emporte sur l’autre : celui d’une immunité qui longtemps (toujours ?) vous sauve de la mort.
Grâce au journal recommencé la vieillesse et la mort elle-même sont de toutes façons pour moi non pas effacées mais inoffensives.
Trop d’œuvres, trop de livres importants, trop de chefs-d’œuvre aussi, de tous les temps, dans toutes les langues. Et j’avais eu l’inconscience d’ajouter à tant et tant de pages imprimées, les miennes dont l’inutilité, comme celle de tant de romans d’aujourd’hui, me frappait soudain. C’est pourquoi me réveillant enfin j’avais décidé de ne pas publier ce Temps accompli 4. Pourquoi, ma fatigue aidant, l’impossibilité où j’étais de taper, et la difficulté d’une écriture peu lisible (je n’avais pas encore pensé à ces gros feutres) m’ont dissuadé de reprendre mon journal – à l’exception des brèves notes dont j’ai déjà parlé (carnet Gauguin et un autre aux pages jaunes…).
Le coq timide de chaque aube non encore perçu. Si présents en moi les coqs de Thaïlande, à la frontière du Cambodge, dans la nuit tropicale. Aucun touriste, alors, là où j’accompagnais Xavier Emmanuelli en Amérique Centrale notamment et à Istanbul même, me semble-t-il.
À la suite du dernier attentat parisien (premier depuis des années), Jacques Chirac a prévu un Samu social qui s’occuperait des blessures invisibles dont restent atteintes beaucoup des victimes de ces drames. On a appris que c’est le ministère de Xavier qui en serait chargé.
Le Monde, arrivé depuis que j’ai noté cela, l’exprime plus exactement sous le titre : Une « cellule d’urgence » couplée au Samu est mise en place par M. Emmanuelli.
Alors qu’une cérémonie officielle à la mémoire des victimes de l’attentat du RER doit avoir lieu dans les prochains jours, le président de la République Jacques Chirac a reçu, lundi 31 juillet, Françoise Rudetzki, présidente de l’association SOS-Attentats, créée à la suite de la vague terroriste de 1986. Pour Mme Rudetzki, « le suivi, au niveau de l’indemnisation en France ne pose plus de problème », mais « le suivi moral et psychologique n’est pas assez développé ». Elle a trouvé un écho favorable à son souhait auprès du président, puisque, dès vendredi 28 juillet, le secrétaire d’État à l’action humanitaire d’urgence, Xavier Emmanuelli, annonçait la création d’une « cellule couplée au Samu, pour venir en aide aux victimes d’attentat, de catastrophe, d’accident collectif ». La cellule s’est réunie une première fois le jour même, en présence du chef de l’État et de M. Emmanuelli.
Marie-Claude me fait remarquer que personne ne s’est occupé de Gilles après l’accident qui faillit lui coûter la vie. Il sut la mort là, et en demeure sans doute à jamais marqué. D’où les [un blanc dans le manuscrit] de sa vie, depuis lors.
Et cette nuit encore, je pense, et je note : C’est un fait que juste avant, juste pendant ou juste après le moment exact de cet accident, j’ai eu, à Venise, l’envie, à peine répressible, de [me] mettre à genoux, là, à la terrasse du Florian.
À Venise où [nous] ne sommes plus revenus depuis, à Venise où je n’écrirai jamais plus…
Grande difficulté et fatigue pour écrire d’un élan et relire ces quelques pages.
19 h. Il y a le temps du journal (le matin) et le temps bien plus long, vide, oppressant, sans journal.
Petite lueur de cette note à la fin d’une nouvelle journée de canicule ici. Je viens d’essayer pour la première fois de la journée de sortir et n’ai pu rester dehors.
21 h. Un journal sur le journal peut-il intéresser un, des autre(s) que moi ? C’est pour moi que je l’écris, même si je pense à une publication d’ensemble éventuelle.
G. Vendredi 4 août 95. – Ce salut par le journal est une connerie, disons, pour être poli, une illusion car sa composition, lorsque je ne l’ai pas abandonné, est de courte durée, si bien que je me trouvais donc, presque toujours, en perdition. C’est ce que j’ai éprouvé et noté, hier soir, à minuit : Mon Journal. Parfois abandonné mais jamais oublié. Ce qui compte pour moi, plus que son intérêt éventuel, c’est le fait même de l’écrire. Aiguille sur le disque du temps.
G. Samedi 5 août 1995. – 2 h 20. – Un espace si souvent emprunté et depuis tant de millénaires que je me demande comment une seule parcelle exploitable pourrait n’avoir pas été défrichée. Si je m’obstine ce n’est pas d’Héraclite qu’il s’agit ni de Saint Augustin mais de moi. Et pas plus de [un blanc] que de [un blanc]. De moi, parcelle d’être de nouveau emportée par le temps avant d’être engloutie.
2 h 35. – Cramponné aux débris du naufrage de « mon œuvre » j’essaye follement de me rassurer, au risque de paraître ridicule en citant des grands noms qui, le plus souvent, ne sont pour moi que des noms. « Si, philosophiquement cela tient le coup », me disait Maurice Clavel du Temps immobile, et je le croyais d’autant moins au fond de moi-même que je sentais, que je savais qu’il m’avait à peine lu.
Mon cerveau fonctionne un peu trop (dans la mesure de mes capacités) pour que je ne m’inquiète pas…
2 h 53. – Je vais essayer de m’arrêter et de me rendormir.
3 h 30. – De toutes façons même pour les plus grands il n’y a pas de clef…
7 h 10. – Un auteur encore plus ordinaire que moi se croit du talent, si ce n’est du génie, pour ceci seulement que ce qu’il écrit est, dans sa banalité même (à lui-même inconnue) l’exact reflet de ce qu’il croit être. D’où, au moment où il achève une œuvre, l’euphorique certitude de la réussite. Quel écrivain n’a-t-il pas vécu cela ?
La difficulté pour retrouver le sommeil est de fermer le robinet…
Je renonce à suivre Xavier à la trace. Il y a trop d’empreintes.
G. – Jeudi 10 août 1995. – Semaine de désaffection et de démoralisation. De nouveau en attente et espérance du journal. En recevant déjà de ce journal mais dont je sais ce que je vais écrire – de personnel – la détente, la confiance et la paix.
Trop personnel, sans doute, pour que je ne doive pas y faire des coupures pour le T.a. 5. J’aurai scrupule à publier ce qui m’est d’un tel secours. Une nouvelle lettre de Jacky Bertrand qui m’apprend qu’il est professeur d’histoire et géographie au lycée C… de C… Je ne retrouve pas les quelques lignes qui me l’a [l’ont ?] rendue si précieuse, celles où il voit (enfin !) dans Le Temps immobile « une des réussites du nouveau roman », ce qui légitime enfin ma présence sur la fameuse photographie dont tous les auteurs, sauf moi, étaient publiés aux Éditions de Minuit. L’état de « mes yeux » (mes !) est une des raisons de mon silence, ici, de ces jours derniers. L’écriture de Jacky Bertrand est de surcroît minuscule et je n’ai pas vraiment pu lire sa lettre – que voici confiée à Jean Allemand pour qu’il la dactylographie.
[lettre de Jacky Bertrand du 2 août 1995]
Je ferai éventuellement les coupes indispensables. Oui, trop c’est trop et je n’ose, même ici, du reste à peine, les évoquer de moi à moi : l’encadré de La Croix et dans une carte d’Eric Sanniez reçue hier : « Je relis quelques tomes de votre journal : sublime. » J’ai osé.
Il fallait l’excès même de ces éloges pour faire contrepoids à mon désenchantement et remettre en marche le moteur…
Je vois vraiment très mal, ce matin. L’un des tomes à paraître du Temps accompli sera intitulé : Travaillez quand vous avez encore la lumière. L’autre s’appellera : Oui, mais alors que faites-vous du lac Tibériade, l’un ou l’autre titre conviennent aussi bien au T.a. 4 qu’au T.a. 5.
La lumière… Oui. Quand au rêve du lac Tibériade (T.a. 4), [p. 190], il me révèle à moi-même la présence sous-jacente et sombrement éclatante (si j’ose dire) de la foi.
Dimanche dernier, à la messe télévisée que je suis presque chaque semaine, j’ai été ému par la jeunesse rayonnante, le rayonnement paisible des religieuses du Carmel de la paix à Mazelle (Saône-et-Loire). Il m’est difficile de me rendre à moi-même précis ce qui était, au moment même si indistinct en moi, si péremptoire, pourtant. Et c’est là que le Journal, est pour moi, d’une importance vitale.
Je ne peux relire la suite de mes notes du petit matin. Ai du mal aussi à exprimer ce dont je me souviens qu’il me fallait l’exprimer. Je me disais (pour me rassurer) que même un journal indiscret de cette sorte pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres que moi-même. Comme s’il pouvait n’être pas inutile (ni vaniteux) d’essayer de dire ce qui ne l’a peut-être jamais été (tel, au moins, que je l’éprouve) : le fait qu’un journal en cristallisant des intuitions et des pensées fluides, peut être, pour d’autres aussi, une solution. La solution après la dissolution. Voie à tracer – Voie tracée. Voix engloutie en partie enregistrée si cryptée. Et notre néant un instant vaincu et matérialisé dans des brèves lueurs…
G. Vendredi 11 août 1995. – Bertrand. Un visage que je reconnais mais plus dur, plus marqué que je l’ai jamais connu. Ainsi c’était lui que j’ai tant aimé ? Que j’aime tant. Et surtout, Bertrand mal rasé… Mais alors ? Je le croyais un enfant encore, comme je l’étais aussi. Est-ce dans mon rêve ou au moment de mon réveil que je me suis dis qu’il était peut-être devenu un homme, déjà sans que je le sache ne sachant pas où j’en étais moi-même, ne pressentant rien, ne sachant rien de la puberté proche.
Nous nous sommes vus pour la dernière fois au début de juillet à Vémars (des photos déchirantes en témoignent). Mais il était pensionnaire à Juilly et nous nous rencontrions rarement.
A Juilly où Bruno était, lui aussi, pensionnaire. Il m’avait souvent dit que son frère veillait sur lui, le protégeait. Un Bertrand que je n’ai jamais connu et que le dernier roman de Bruno Gay-Lussac, Arion, un très beau texte, me découvre…
Un autre Bertrand – le frère de Bruno et non plus le mien. Le vrai frère. D’où ma surprise, même en tenant compte de la transposition romanesque, à la révélation du secret à eux deux qui n’était pas celui de Bertrand et de Claude.
L’autre côté de la médaille – et que je n’avais jamais vu ni même pressenti. D’où ce désarroi, ce malaise… [au crayon : insérer ici pasage d’Arion]
Qui est Renart ? Son père a dit un jour de lui : « Il est terrible mais il est bon. » En vérité, le père ne sait rien de son fils qu’il se contente d’observer et de chercher à deviner. Est-il impossible de connaître Renart ? Le seul qui sait quelque chose n’est autre que Ring. Les deux cousins se parlent en secret et ne confient rien de leurs entretiens. Ni à personne. Mais Ring serait incapable de parler de Renart. Il ne peut juger son cousin. Ring est dominé par Renart mais il l’ignore. Il exécute sans s’en rendre compte les inventions souvent diaboliques de l’autre. Mais Ring ignore le Diable. Pourtant Renart a l’air d’un serpent mais il fait aussi penser à un juge, à un sorcier d’une tribu sauvage. Sa parole est rapide, sifflante, cruelle ou menaçante. La parole est pour lui le moyen d’attaquer, de se battre, de fuir ou de se défendre.
Portrait cruel où me console cette complicité qui, sous d’autres noms, nous ensemble, Bertrand et Claude disparaissaient au fond du jardin de Vémars dès qu’ils se trouvaient réunis. Mais nous avions une vie collective aussi, merveilleuse, Bertrand, Claude, Bruno, Claire, Luce. Le radeau où nous naviguions devant le hangar, la cabine de l’avion sous la grande table du salon (dont j’ai hérité et qui n’a pas trouvé sa place) dans le clair obscur d’une petite lampe. Nos traversées, des vols réellement vécus, oui, tous ensemble.
Bruno auquel je ne cesse, ici, de penser, non plus à son roman mais à lui…
Cela tout juste indiqué, les premières de mes notes, ce matin à 6 heures…
Mais ceci, mot pour mot qui s’imposait en ces termes mêmes m’arrachait à chaque nouvelle tentation de sommeil…
… La nuit efface le temps. Mes notes nocturnes ou comme celle-ci du petit matin, sont (me paraissent être) les plus lucides et les plus intelligentes dont j’ai jamais été capable.
Il ne suffit pas que j’aie quelque chose à raconter, car je n’en ai ni la force ni le désir, il faut que j’aie des mots à dire, parfois textuellement dictés et que mon journal reproduit alors. Quand j’écris désormais mon journal (que j’écris, oui, ne pouvant plus le taper et c’est une chance peut-être) le temps durant lequel je reproduis ce qui est tout composé en moi, je ne suis plus le même. Ou, plutôt, je suis un autre qui est vraiment moi.
A la une du Monde daté du 11 août un papier sur 4 col. intitulé Le « Bulldozer » Chirac étonne les Américains… ce que confirme l’article de Sylvie Kauffman. À ceci près qu’on y trouve dans le dernier paragraphe, p. 9 :
On dit aussi le président français « impétueux », « impulsif » « un bulldozer sans volant » selon un diplomate cité par Tom Friedman dans le  . .
Goupillières, Samedi 12 août 1995, 6 h 45. – Pourquoi, à l’exemple de Charles Du Bos, j’inscris ainsi non seulement le lieu et la date mais encore l’heure parfois même à une minute près ?
Je pense à une note que j’ai griffonnée l’un de ces derniers jours. Non pas à approfondir (cette profondeur moquée par Deleuze, au témoignage de Foucault), mais à éclaircir dans la mesure du possible. J’ai d’autant plus de mal à le dire que je sens mais ne sais pas ce que j’ai à dire. J’aimerais bien dormir encore.
(Matin du 12 août) Notes aussi difficiles physiquement à lire qu’elles le furent cérébralement à écrire.
17 h. La débile tourterelle turque a eu raison de moi, ce matin. Alors que tous les oiseaux se sont tus, elle continue en plein mois d’août à répéter indéfiniment [ses] quelques notes monotones. Je l’entends encore, étouffée heureusement par les volets et la fenêtre close. La canicule toujours. Est-ce vraiment son nom – attentatoire au plus divin de tous, tourterelle que j’ai pu entendre il y a quelques jours ? Alors qu’elle a envahi la France et jusqu’au jardin de cyprès où repose Michel Foucault, personne, jamais, n’en parle ni ne donne aucun renseignement à son sujet…
… Marie-Claude à qui je dis que je ne me souviens pas de celui qui nous a appris ce nom de tourterelle turque, que je n’ai, depuis, pu vérifier nulle part, me dit qu’il lui semble bien que c’est à Vendeuvre le jardinier de Michel Foucault, justement, ce dont je me souviens alors très bien et lui confirme aussitôt.
Ce sont de beaux oiseaux effilés, un peu plus gros mais plus minces que les pigeons, au plumage gris léger. Définition de Marie-Claude :
– Des jolies femmes qui ont une vilaine voix…
Ce que je sentais et n’arrive toujours pas à formuler de façon satisfaisante… Privé par mon état de tout voyage et même du moindre déplacement autonome à l’exemple de mes 20’ quotidiennes de marche (20’ et je n’en puis plus de fatigue !) je recours non pas à d’autres voyages dans les profondeurs de moi-même (Deleuze) ni même à un arpentage mais… Plus jamais l’air des montagnes, les sonnailles des troupeaux, le fluide mouvement d’un torrent – et plus jamais la mer, sans doute, ni les paysages inchangés et toujours nouveaux de la France – traversée. Et pas davantage les vols lointains ou proches du métro lui-même que je ne puis plus prendre depuis plus d’un an, faute d’en descendre et surtout d’en gravir les marches, plus jamais les odeurs et rumeurs de la mer…
… Et pourtant je suis toujours là, moi, surfant sur l’eau du temps. Non pas des voyages intérieurs, ni de vains regrets, ni les chagrins à l’état de cicatrices, de l’angoisse toujours non pas tant pour ce qui me menace, moi… Essayant grâce à ce journal de me saisir des parcelles de ma relative personnalité et d’arracher au néant que je suis quelques bribes d’être.
Livre de bord ? À bord de moi-même sur ce navire que je voulais croire malgré ses avaries insubmersible avant le naufrage final.
Mon œil se trouble. J’arrête. Et je n’ai toujours rien su. Rien.
Les dates donc, les précisions horaires pourquoi ? (17 h 50).
G. Lundi 14 août 1995. – Je relis difficilement ces dernières pages. En coupe une. Mon seul instrument : l’écriture. Qui a tendue à devenir littérature…
… Je vois vraiment mal le matin, et ne peux continuer.
G. Lundi 14 août 1995. – Page détruite donc, sur ce que je ne reverrai jamais – ou que j’ai peu de chance de jamais revoir. Et cette phrase née spontanément en moi qui résume, complète, rend inutile, achève ce que je voulais exprimer :
… le vol invisible de la libellule bleue…
Puis ceci, dans le même mouvement…
… il était mal rasé l’enfant Bertrand, Bertrand qui n’était plus un enfant…
Goupillières, mardi 15 août 1995. – « La quête spirituelle » de quatre Libanaises. L’une au visage pur, dépouillé, si jeune sous ses cheveux blancs, me rappelle celui d’une des Bénédictines de l’émission télévisée qui précédait comme celle-là la messe. Même interrogation sur l’émotion que me procure le rayonnement de ce visage d’une chrétienne du Liban. En totale contradiction avec l’impossibilité où je suis d’admettre l’invraisemblable pur. Coexistence, en moi, d’une incroyance absolue, définitive, et d’une présence cachée, secrète et parfois brièvement mais péremptoirement éclatante du christianisme.
Au cours du même documentaire la surprise visible, une fois encore, d’un Liban si familier bien que je n’y aie passé que peu de jours – et quelques heures surtout hors de Beyrouth. Comme une lumière jamais vue ailleurs, une paix spirituelle et en quelque sorte physique aussi, qu’aucun conflit, aucune guerre n’avaient pu, depuis des siècles, atteindre. Il est vrai qu’ils étaient lointains, alors[,] les canons que j’entendis.
Messe décevante à Notre-Dame de la Garde, que j’interromps pour écrire cette note où je lis, ce matin du 16 août, ceci :
… Pages illisibles à recopier si cette altération de ma vision n’est comme je l’espère que passagère…
… J’ouvre de nouveau la télévision, assiste encore aux dernières minutes de la messe et où j’ai la surprise d’un Ave Maria surgi de l’enfance, arraché à sa banalité et rendu à la ferveur des âmes simples qui le chantaient autrefois…
G. mercredi 16 août 1995. – De José Cabanis, daté de « dimanche soir » (13 août) :
Rentrant de la messe ce matin chez les Clarisses, ma voiture a fait un saut brusque sur la droite et est entrée dans le décor. La voiture est morte, moi intact. Belle occasion perdue, j’avais dans le corps Dieu en personne. Quel passeport pour le ciel !!!!
 Lazare Lazare
Je lui téléphone aussitôt. Il n’a rien eu et continue de le regretter.
Lui, les blessures. Moi les Bénédictines…
De l’humour dans la signature, mais le plus grand sérieux, sans affectation aucune, dans son regret de ne pas être mort…
Dans leur jardin de Brétigny où, à l’initiative de Pierre et sans qu’elle l’ait su avant le dernier moment, était fêté hier l’anniversaire de Régine Deforges.
Une trentaine de proches accueillis avec grâce, élégance, gentillesse par une Régine fraîche, belle et cachant sa tristesse. Joie de voir Pierre et sa fille Léa. Simplicité, gaîté, chaleur de l’amitié. Régis Debray si attentif à ma présence que j’en suis étonné. Il me félicite d’avoir après bien des hésitations accepté cette première sortie, depuis des années peut-être. J’ai bien tenu le coup. Marie-Claude en est ravie et je retrouve mon aisance d’autrefois, dans ma jeunesse, lorsque les réceptions de ce genre m’amusaient.
G. Jeudi 17 août 1955. – Nouvel attentat à Paris, place de l’Etoile, à la sortie du R.E.R. Moins terrible que le précédent. Mais glaçant.
G. Vendredi 18 août 1995. – Par milliers, en un seul soir, les martinets d’Istanbul. Par milliers, d’été en été, l’ancre noire des martinets de Paris, de Bordeaux, de Marseille. Et puis je ne les ai plus entendus. Et puis je ne les ai plus vus. De la stridence au silence. Une absence de plus au sein même de l’inaudible et de l’invisible présent.
Sur une des photos de ses fils envoyée par Nathalie de Lakeville :
Lakeville. Juillet 95. En canoé sur le lac : « I wish the boat was bigger and Mamouchka et Papa Claude could set in. »
Samedi 19 août 1995. – De Christine Clerc, dans Le Figaro : au sujet de la « cellule d’assistance psychologique » créée par Jacques Chirac :
… Il allait en confier la mission au Dr Xavier Emmanuelli, secrétaire d’ État à l’Action humanitaire, auquel le lie, depuis la création du « Samu social » voilà bientôt deux ans, une singulière complicité mêlée de respect…
G. lundi 21 août 1995. – Ma libellule s’est envolée. Je feuillette en vain les dernières pages de mon journal et ne la retrouve pas.
… Deux jours après, Marie-Claude vient toute joyeuse à la fenêtre du bureau et me signale qu’elle vient de voir ma libellule…
J’avais cru qu’il n’en existait plus ici, tuées comme les grillons, les sauterelles et la plupart des papillons par les poisons dont on arrose les champs…
La moindre manipulation me demande de longues, exténuantes minutes…
G. mardi 22 août 1995. – Jospin est le nouveau leader (non encore officiel) du P.S. dont on se demande, (le mot s’étant vidé de toute espérance et même de toute réalité, de toute possibilité) comment il fait en continuant à s’appeler socialiste, prétendre à la reconquête du pouvoir, qu’il n’est pas exclu, pourtant, qu’il reprenne tel qu’il est (n’étant rien) un jour. Il a raison… (5’ à chercher en vain en fouillant les divers journaux)… de déclarer que si la gauche doit être solidaire de la majorité dans sa lutte contre le terrorisme, elle ne saurait oublier que [si] Jacques Chirac a été élu président de la République, c’est en trompant les Français sur ce qu’il ferait à grande échelle pour les sans-domicile-fixe et pour lutter efficacement contre le chômage.La fatigue de cette vaine recherche d’une citation précise rend difficile la rédaction d’un journal dont je remets de jour en jour la composition…
… Naturellement j’ai voté Jospin. Mais qu’aurait-il pu faire de ma voix ? Et puis, il faut le dire, bien qu’il ne s’agisse plus là de politique rationnelle, que Jacques Chirac, dans ses probables erreurs mêmes et dans ses possibles réussites, me fascine…
Je l’ai rencontré en [1982] lors de l’inauguration de la plaque apposée sur notre maison avenue Théophile-Gautier. Je lui avais serré la main sans chaleur et n’avais pas apprécié d’être photographié à son côté. Tel était notre comportement de l’époque, à nous qui nous disions « de gauche », et Chirac était pour nous l’adversaire même, dont on disait, croyait et absurdement qu’il était de tendance fascisante.
Je l’ai revu lors de l’inauguration du quai François-Mauriac. Maire de Paris, toujours et encore, mais sans que nous le sachions à la veille même de l’annonce de sa candidature, jugée prématurée, à la Présidence de la République. On sait combien fut difficile pour lui ce combat qu’il remporta à la fin, tous les R.P.R. qui l’avaient trahi pour rejoindre Balladur, lui étant, au dernier moment, et alors que son élection paraissait acquise, revenus.
Nous eûmes ce jour-là deux assez longues… conversations, le mot est certainement exagéré. Enfin nous nous parlâmes. Il revint, courtoisement à moi, la cérémonie achevée. Même à l’époque de notre plus grande méfiance si ce n’est même hostilité à son égard, nous savions combien ceux qui l’approchaient célébraient sans cesse sa gentillesse – sa bonté. Me frappa alors le rayonnement immédiat de sa séduction. J’avais beau me dire que nous le voyions tel, à la télévision, lors de ses moindres rencontres, je me sentais touché. Il m’avait eu comme tant d’autres, mais sans tricherie, parce que telle était sa nature. Comme n’importe quel autre de ses interlocuteurs d’un moment, il me conquit dans la seconde, le temps, du moins, de ce bref face-à-face.
Nouvelle recherche – sans résultat – pour les dates. Fatigue et découragement.
Je disais au téléphone à Gilles que, les jours où je n’écris pas de journal, je suis comme une méduse échouée sur la plage et s’y desséchant. Et je crains toujours qu’il n’y ait plus de marée montante pour moi.
Le journal désormais est perfusion, ballon d’oxygène. Il me sauve d’une sécheresse qui n’exclut pas une souffrance quotidienne – le mot n’est pas trop fort, devant notre écran de télévision, surtout lorsque dans cette suite d’horreur ce sont des enfants qui sont frappés. Mais Jankélévitch avait raison : la compassion n’est pas l’amour…
G. Mercredi 23 août 1995. – José Cabanis me signalait l’autre jour un passage sur moi du Bloc-notes qui l’avait frappé. Je croyais alors ne pas avoir ces volumes ici où je n’étais pas revenu depuis près d’un an. Il me dit alors qu’il allait le recopier à mon intention.
À peine avais-je achevé, hier, mon journal que je le recevais…
Académie Francaise
23, Quai de Conti, VIe
François Mauriac.  , page 59. , page 59.
« Samedi 4 avril 1953.
Qu’il existe au moins une joie que la vieillesse seule peut donner, je ne l’aurais pas cru. Cette journée passée tout entière avec 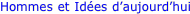 , de Claude. Ce jugement si net et toujours étayé de textes, cet amour de ce qui est l’objet de sa critique, cette liberté à l’égard de tous les tabous d’une génération incroyablement soumise et docile, tout m’enchante – et d’abord le plaisir d’apprendre de lui ce que je n’avais pas su voir sans lui. Bien loin d’être peiné de son admiration pour d’autres ou jaloux des influences subies, je m’en serais réjoui au contraire (comme de tout ce qui atténue mon inquiétude d’avoir gêné son développement) n’était le problème religieux. Mais qu’aurait valu une foi “de famille”, une attitude conventionnelle de fils de son père à l’égard de ce qu’il y a de plus individuel, de plus secret : nos rapports avec Dieu ? Sur ce plan non plus, il n’aura pas été à ma remorque. De ce côté-là aussi j’ai confiance qu’il fraiera sa Voie, non, certes, tout seul : nous ne sommes jamais seuls, même quand nous croyons l’être. » , de Claude. Ce jugement si net et toujours étayé de textes, cet amour de ce qui est l’objet de sa critique, cette liberté à l’égard de tous les tabous d’une génération incroyablement soumise et docile, tout m’enchante – et d’abord le plaisir d’apprendre de lui ce que je n’avais pas su voir sans lui. Bien loin d’être peiné de son admiration pour d’autres ou jaloux des influences subies, je m’en serais réjoui au contraire (comme de tout ce qui atténue mon inquiétude d’avoir gêné son développement) n’était le problème religieux. Mais qu’aurait valu une foi “de famille”, une attitude conventionnelle de fils de son père à l’égard de ce qu’il y a de plus individuel, de plus secret : nos rapports avec Dieu ? Sur ce plan non plus, il n’aura pas été à ma remorque. De ce côté-là aussi j’ai confiance qu’il fraiera sa Voie, non, certes, tout seul : nous ne sommes jamais seuls, même quand nous croyons l’être. »
À lire une telle page, joie, joie, pleurs de joie. J. C. 20 Août 95.
… Ainsi avait-il pris la peine de me recopier cette page de sa main.
L’adéquation devient de plus en plus aléatoire entre mon journal et le T.a. 5, tels que je les voyais lorsque j’ai entrepris la composition [de] Travaillez quand vous avez encore la lumière. Mais je ne pouvais pas ne pas insérer dans mon journal ce texte de mon père même si sans doute je n’ose pas, le moment venu, le citer dans le T.a. 5.
En remerciant José Cabanis – qui taillait une haie de son jardin lorsque je l’ai dérangé, je lui disais l’étonnement – pour ne pas dire la stupéfaction – je l’ai dit – en découvrant que je n’avais gardé aucun souvenir, tout au plus, à la réflexion, une vague trace effacée – de ces lignes pour moi si émouvantes. Y entendre mon père parler ainsi de moi me bouleverse. Les dernières lignes de ce texte ont touché à l’âme Marie-Claude et Cabanis dans la mesure où ils éprouvent l’une et l’autre pour ma vie spirituelle une si vive attention. Une telle tristesse de mon manque de foi, une même espérance dans ma possible conversion. D’où le P.S. pascalien de José qui n’est extravagant que s’il me concerne, moi, alors que s’y exprime la foi rayonnante de José et sa joie d’entendre François user à l’égard de Claude, dans les phrases finales, des mots qu’il a si souvent employés à mon sujet dans la même lumière et la même espérance.
Ainsi va à grand train le journal. Je ne vois pas si mal puisque je peux l’écrire et le relire. Tout se passe comme si je craignais que le temps me fût compté (il m’est compté, le temps !) où je verrais suffisamment pour le composer. Je vaincs une bien naturelle superstition pour écrire cela. Si je savais que ma vision, si imparfaite soit-elle, ne baisserait pas, resterait la même, combien je m’accommoderais de son insuffisance – suffisante à l’écriture d’un journal…
… L’idée, aussi, que le T.a. 5 étant resté inachevé soit posthume. Aucun empêchement, dès lors, de m’y exprimer librement.
… Et puis, ce n’est pas seulement (pas surtout) de la lumière des yeux qu’il s’agit.
G. Jeudi 24 août 1995. – Si je n’avais quelques lecteurs intéressés, voire touchés par ce que je dis non plus de mes grands et moins grands hommes, mais de moi, je serais paralysé – comme ce matin, mais je vais essayer de passer outre – par la crainte de n’écrire pour rien ni pour personne sinon pour moi seul.
L’une de mes plus anciennes fascinations est celle de la beauté et du mystère des zeppelins de mon enfance. Celui ou ceux amerris dans des hangars sur le lac de Constance, le zeppelin pris après la guerre aux Allemands et qui survole Paris au matin de ma petite enfance… Il est là comme si je l’avais vu et le voyais à jamais, long fuseau pâle, dérivant lentement, glissant dans la grisaille du ciel, encadré par une fenêtre, que je vivais elle aussi, de notre appartement de la rue de la Pompe. Mais je doute depuis longtemps de sa présence ailleurs qu’en moi-même. Peut-être en ai-je seulement vu les photos dans le journal du lendemain…
Le Dixmude aussi et surtout et sa disparition dans une brève et immense lueur, au large… de la Sicile ? Je conserve pieusement à Paris le livre si cher à mon enfance où était raconté, pour moi d’une telle poésie, la vie de son commandant Jean Duplessis de Grénédan, ineffacé en moi. Poésie qui précéda celle du biplan dont je ne revois avec moins d’émotion les images que depuis peu d’années. Le hasard a voulu que lundi et hier soirs des zeppelins naviguent dans le ciel de notre petit écran. L’un, plus ou moins bien reconstitué, trop petit sur Arte dans un attachant film allemand, Berlinger. L’autre, hier, au cours d’un curieux documentaire de T.F. 1 consacré à quelques personnages vivants, qui portent des grands noms de l’Histoire – dont le comte Albrecht von Zeppelin, dixième du nom, évoquant pour ses enfants, dans son impressionnant château, les dirigeables inventés et créés par leur arrière-grand-père. Avec un flash sur la catastrophe (il en reste des images) qui détruisit en quelques secondes, un peu avant la guerre, le dernier zeppelin à son arrivée à New York… il serait question d’en créer d’autres, dit-on…
Les zeppelins ont gardé pour moi la puissance, la douceur poétique qu’on partiellement perdu la Tour Eiffel, et les bordels populaires et le cirque, démagnétisés depuis que je les ai chantés dans certains de mes textes.
Mais qui peuvent intéresser ces pages de journal où j’ai tenté de mettre la poésie dont irradiaient pour moi les zeppelins d’autrefois ?
Même si je pense à en publier la plupart, ce n’est que pour moi que de tels, souvenirs ? non, présences ont du prix. Je ne peux que me répéter, (que faisons-nous d’autres, écrivains, que de nous répéter ?) j’ai retrouvé la bouée du journal, je m’y accroche. Longtemps le moteur n’a même pas tourné et puis à Goupillières propice au travail, il a ronronné, grondé et j’ai soudain décollé…
(25 août). L’impropriété du mot soudain m’a frappé. Long fuseau pâle dérivant… un dirigeable ne dérive pas. Dès la fin du repos où cette correction s’était imposée à moi, j’ai effectué la correction. Il est, vu du dehors, ridicule, mais pour moi significatif qu’après avoir remplacé un mot par un autre dans mon manuscrit j’ai jugé indispensable de signaler la correction dans la suite même du texte. Faisant ainsi le travail habituel des universitaires dans leur examen minutieux des manuscrits. L’avoir fait sur un de mes propres textes cesse d’être inadmissible, ridicule. Si l’on veut bien admettre, mais je suis seul à pouvoir le faire, que ma façon nouvelle d’écrire mon journal implique l’insertion dans le texte même de ce qui de la part d’un lecteur professionnel et extérieur aurait été indiqué en note. (Énergie vainement dépensée dans ces recherches matérielles, rendues lentes et difficiles par ma vue imparfaite… Après plus de 5’ de survol de quelques pages du Télérama de cette semaine, je n’ai toujours pas trouvé le commentaire sévère du critique qui se moquait de la grandiloquence d’un documentaire qui m’avait ému. Celui où l’on voyait, entre autres “ héritiers ” le comte Zeppelin actuel. Mais le sable du temps dont ce commentateur se gaussait me paraît beau, la banalité du sablier n’étant pas en cause. Trop souvent les critiques de Télérama (lorsque ce n’est pas Jacques Siclier, son érudition, mais aussi son intelligence, son cœur, son âme) parlent avec désinvolture d’œuvres cinématographiques et surtout télévisuelles qu’ils assassinent alors qu’ils sont seuls à les avoir vus, encore. Mais aucune œuvre consacrée n’échappe à leur admiration.
G. Vendredi 25 août 1995. – Écrire. Le mari de Carson McCullers, Reeves est désespéré de n’y pouvoir parvenir, à l’exemple de son épouse qui remporte le succès du Cœur est un chasseur solitaire. Dans la série de Bernard Rapp, Un siècle d’écrivains (FR 3), inégale mais le plus souvent enrichissante (même lorsqu’on croit connaître l’auteur présenté), on voit donc, au cours de l’émission consacrée à sa femme sœur, cet homme désespéré – le mot n’est pas trop fort – Reeves McCullers devant une page inévitablement définitivement blanche. Désespoir que j’aurais trouvé excessif, que je n’aurais pas compris il n’y a pas si longtemps, alors que je publiais depuis des dizaines d’années, déjà – et qui lors de cette récente expérience, m’est devenu aussi clair, alors, que si c’était moi qui avais été frappé de cette stérilité. Écrire comme un impératif. Seule voie ouverte au salut que l’on pouvait espérer. L’absurdité même pour tous ceux d’une vocation autre, ou comme dans ce cas-là, interdite.
… même la moindre correction de pagination me pose de peu supportables problèmes…
Mes ténèbres zébrées d’éclairs…
[lettre de Jacky Bertrand du 24 août 1995]
Goupillières, lundi 28 août 1995. – Hier soir, avant d’essayer de dormir, j’ai pris conscience que je ne pensais plus, à ce moment-là (et à bien d’autres) à Bruno… Je me suis jugé, une fois de plus, avec sévérité. Et me suis alors surpris à dire à mi-voix : « Mais qui est ce moi ? » éprouvant cette impression non pas tant d’absence à moi-même que d’inexistence ou de vague existence anonyme. Phénomène dont j’ai parfois parlé ici et que je n’avais pas revécu tout au moins avec intensité depuis longtemps. Sentiment vertigineux de dépersonnalisation totale. Je n’étais plus responsable de moi puisque ce n’était plus moi qui étais là, je veux dire une personne identifiable.
Voici des mois que je refuse de parler de Bruno dans mon journal. Pour exorciser et ne pas laisser de trace d’une inquiétude de plus en plus vive, avec après quelques rémissions l’effroi pur, tel que je l’ai vécu hier, lorsqu’il m’a brièvement répondu au téléphone « Je dormais… » d’une voix si faible qu’on pouvait vraiment, au-delà des clichés habituels, dire mourante.
(Paul Brach, après avoir monté l’escalier, se laisse tomber sur la banquette du palier, et dit à son ami, venu l’accueillir, pour expliquer sa fatigue, la formule habituelle : « Je suis mort ! » Et mourut.)
Arnaud Gay-Lussac que j’appelai aussitôt me dit, sans phrases et avec une simplicité bouleversante de son père qu’il avait vu comme chaque jour :
– Je suis très inquiet. Il dort tout le temps, il s’éteint peu à peu…
J’aimerais croire que, Bruno ayant survécu, je pourrai détruire bientôt ces pages devenues sans objet. Contrairement à mon silence habituel j’ai décidé ce matin de me confier à ce journal. Me… Moi réapparu après une courte disparition : hier soir un court effondrement, un effacement d’un monde qui continuait d’exister autour de lui[,] qui n’était plus rien ni personne qu’un être vivant sans nom dilué dans un vide d’avant la création[,] à ceci près qu’une parcelle d’être flottait dans l’espace incertain d’avant la création.
Le journal, donc, pour me cerner moi-même, me retrouver vivant et intact. Et surtout pour exprimer par des mots, matériellement visibles, écrits, la honte, alors qu’il a tant compté pour moi, de souffrir abstraitement, à quelques coups de cœur près comme hier, de l’épreuve que vit mon cousin. Impression pénible d’avoir en en parlant, donné une réalité à la mort de Bruno, devenue proche, inévitable, alors qu’elle pourrait encore être différée.
Bruno que j’ai tant aimé dont la vie m’avait séparé…
En m’envoyant le Bloc-notes d’outre-tombe audacieux et brillant qu’il vient de composer, Jean Touzot m’écrit qu’il a travaillé cet été, à « une édition du Nœud de vipères, préfacée et annotée pour le Livre de poche. En relisant L’Éternité parfois j’ai découvert que pour la mort de Marie votre père s’était inspiré des dernières paroles de Bertrand Gay-Lussac… »
23 h. Cette expérience de l’improbable moi doit avoir été commentée par bien des philosophes (pour ne parler que d’eux) car c’est celle, connue sans doute de tous, de l’être sans ancrage.
Goupillières, mardi 29 août 1995 – 6 h 50. – J’ose à peine raconter ce rêve d’où j’émerge, tellement il est gonflé (c’est le cas de le dire). On me signale un ballon rond en plein ciel. On m’y annonce l’inscription de mon prénom et de mon nom presque effacé que je déchiffre non sans peine en effet sur le tissu. De l’autre côté apparaît le nom de François Mauriac. J’oubliais : il y avait ma photo dont je demandais à Gilles s’il l’avait remarquée. Voilà ce que je rêve, alors que Bruno…
… Réveil tardif. Longues minutes avant que je pense à Bruno, ce qui, une fois de plus, me fait honte.
G. jeudi 31 août 1995. – Dernier rêve juste avant le réveil. Couché au bord d’une allée forestière avec l’impression que j’ai dormi beaucoup trop tard. Des amis (non identifiés) s’affairent sans que je comprenne ce qu’ils font. L’un d’eux achevant de la monter :
– C’est la tente de Camus…
Je me lève. Vois quelque chose d’insolite au sol. C’est une petite tortue dont je crains que, dérangée, elle roule sous sa carapace. Je pense – textuellement : « Chouette, une tortue à Goupillières… »
Et me réveille.
Goupillières, vendredi 1er septembre 1995. – Un de mes manques, de mes trous après tant d’autres : j’ai longtemps ignoré Fernand Braudel. Il y a quelques années il m’avait été découvert. J’écoutais toute une après-midi ici, à France-Culture, une émission passionnante sur lui. Le Figaro Littéraire de cette semaine lui est en partie consacré. J’y lis que sa découverte de « la longue durée » qui m’avait fasciné, « il l’avait inventée pour échapper aux misères de sa longue détention » de prisonnier de guerre. Et ceci, sous la signature d’Alain-Gérard Slama :
… L’auteur de La Méditerranée invitait les confrères à regarder la plaine de l’histoire événementielle avec la lunette du temps cyclique (la conjoncture) et le télescope du temps immobile (les structures)…
C’est cela, justement, qui m’avait passionné chez Braudel.
Goupillières, dimanche 3 septembre 1995. – 11 h 45. Avant la messe télévisée à Huppy (Somme) nous fut découvert le château où le colonel Charles de Gaulle avait son quartier général en juin 40…
… Hier soir nous vîmes à la télévision sur Arte un documentaire sur la drôle et la plus drôle du tout de guerre. Le titre, admirable, Le Temps détruit, a été emprunté à une lettre de Paul Nizan à sa femme. Deux autres soldats écrivent ainsi à leur épouse de belles lettres d’amour avant d’être tués, eux aussi, au cours des combats que, contrairement à celui que commandait de Gaulle, la défaite a effacés. Il y eut pourtant en 40 beaucoup de victimes – « plus de cinq mille morts » assure l’auteur du compte rendu de Télérama : le capitaine Maurice Jaubert – dont nous entendîmes la musique déchirante – dont le fragment de L’Atalante qui, pour des raisons personnelles, m’est si cher. Le soldat Roger Beuchot que son fils Pierre a célébré en 1985 dans ce film si beau, si difficilement supportable, du fait aussi des images d’actualité de l’époque qui nous y sont montrées : vieux généraux sortis embaumés de la guerre de 14, sympathiques, oh combien sympathiques soldats français dont les visages débonnaires, les uniformes défraîchis, les armes désuètes nous glacent lorsque nous pensons [à] ce qu’étaient en face d’eux les guerriers casqués dont le cinéma nous présentait alors les images qui nous inquiétaient sans pour autant nous faire mesurer notre impréparation. Avec l’optimisme conquérant et la propagande débile des premiers mois, puis l’effondrement auquel Paris répond en promenant en procession la châsse de Ste Geneviève. Oui, elles étaient insupportables ces images lorsque l’on savait ce qui allait advenir de ces soldats-là et de la France. Devant une école tous ces enfants rieurs, avec en bandoulière leurs trop grands et dérisoires masques à gaz – enfants parmi lesquels, me dit Marie-Claude, devaient se trouver des petits Juifs… Je dis très mal tout cela parce que je l’écris trop vite. Et que, contrairement à la plupart des pages précédentes j’éprouve, en écrivant celle-ci ce matin, une fatigue dont me délivre [en surcharge : sauve] ici l’oxygène du journal.
La fin aussi… interrompue par un appel de Gilles qui m’annonce un nouvel attentat, au marché Richard-Lenoir, une bombe artisanale qui aurait pu être meurtrière ce jour-là à cet endroit-là – ayant une nouvelle (encore) fois dans sa cocotte-minute mal fonctionnée… Quelques blessés légers…
… La fin aussi de ce qui me paraît être soudain, je n’y avais jamais pensé et ne l’avais jamais nommée, une dépression due à divers malaises et au fait que dans le brouillard partiel de mon œil valide, je craignais de perdre la vue. J’ai enfin pu réagir ici, m’acceptant tel que j’étais devenu et réapprenant à écrire et, non sans quelque gêne, à lire… Luce me dit qu’une dépression dure en général neuf mois. Le compte est bon…
J’écris à Yves Berger, en lui annonçant la relecture et mise au point du T.a. 4 et l’amorce d’un déjà conséquent T.a. 5 : « Mes vacances m’ont arraché à ma vacance… »
Goupillières, lundi 4 septembre 1995. – Je m’étais proposé, mais je n’ai pas eu ce matin le courage de recopier les pages précédentes où je m’étais trop vite et mal exprimé. C’eût été la première fois que je n’aurais pas conservé mon journal tel que je l’avais directement composé.
Découverte près du marché de la rue de la Convention d’une nouvelle bombe qui aurait dû exploser hier en même temps que celle du Bd Richard-Lenoir.
Nous rejoignons Paris en fin de journée.
Paris, mardi 5 septembre 1995. – Rencontré Mitterrand en rêve dans un lieu public. Il me salue d’un « Content de vous revoir C. M. ». N’a pas un regard pour les personnes qui m’entourent et s’en va sans saluer l’homme important auprès duquel je me découvre et dont je découvre sans m’en étonner qu’il s’agissait de Mitterrand lui-même…
Paris, mardi 12 septembre 1995. –
Guillemin, Parcours, p. 355 :
« Claude Mauriac m’envoie (pour dédicace, ce seul mot : « fraternellement ») le Tome X de son 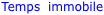 . Quel monument, au total, ces dix volumes ! Quel trésor, quel gisement d’information sur la vie littéraire, et la vie de la France, pendant plus d’un demi-siècle ! » . Quel monument, au total, ces dix volumes ! Quel trésor, quel gisement d’information sur la vie littéraire, et la vie de la France, pendant plus d’un demi-siècle ! »
Ce n’est pas moi qui le dis. Enfin un peu de pluie et de fraîcheur ! J’ai achevé le  . Guillemin est une petite récréation. . Guillemin est une petite récréation.
Fraternellement. J. C.
J’étais de nouveau complètement engourdi. Pas un vrai journal, pas une lettre depuis mon retour à Paris. Et puis je reçus ce matin de José Cabanis – toujours si attentif et chaleureux – (« ton Argus vivant », me dit Marie-Claude) cette carte.
Je me rappelais ce « fraternellement » cité par Henri Guillemin dans un de ses livres. Mais ne me souvenais pas d’une seule phrase, d’un seul mot donc de son appréciation, pourtant si précieuse pour moi, du Temps immobile.
Et me voilà réanimé. De quoi aurais-je l’air si je reproduis ce texte dans un Temps accompli publié ? De la vanité il y a sans doute en moi, puisque dans cette perspective on la signalera et on s’en moquera. Justement, sans doute, à ceci près (je me répète !) qu’il ne s’agit chez moi d’un juste orgueil que dans la mesure où un tel jugement me remet à flot, m’arrache à la torpeur où je m’ensevelissais. J’apprends chaque fois à nouveau – et avec quel étonnement ! – que le Temps immobile est une œuvre (pas de guillemets !) et en suis rempli non pas de joie : d’oxygène me permettant enfin de respirer. C’est attacher beaucoup d’importance à soi-même. Mais c’est de soi, justement, que l’on doutait…
Oxygène. Le mot que je répète parce que je n’en trouve pas d’autre qui réponde à ce que j’éprouve.
Vanité, soit. Mais c’est que j’oublie (la preuve !) même ce qui a compté le plus pour moi. Car je ne doute pas avoir eu la connaissance de ce texte de Guillemin où seul surnage le mot « fraternellement ». C’est dire que ma force d’oubli compense ma vanité.
D’une des petites bêtes en peluche qui enchantaient encore Marie-Claude au moment de notre mariage et auxquelles j’avais pris goût, nous disions « qu’elle se nourrissait de compliments ».
Paris, mercredi 13 septembre 1995. – Les rêves les plus difficiles, les moins divertissants, franchement désagréables et que l’on rompt avec bonheur lorsque la possibilité vous en est par le réveil donnée sont ceux ou on a [à] lire un texte, qui n’existe pas et qu’il faut essayer d’inventer à mesure et plus encore ceux où l’on essaye de composer une œuvre – en ce qui me concerne littéraire, comme encore la nuit dernière.
Je le note en me demandant une fois de plus qui cela peut intéresser et à quoi peut être bon un journal pour un autre que celui qui l’écrit. Mes arrière-pensées de publication, précisées à Goupillières ces temps derniers me paraissent de nouveau dérisoire – sans que j’y renonce encore…
… D’autant plus que ce qui nous occupe, nous préoccupe vraiment est absent d’un journal où, sans les oublier, je les exclus par inutilité de réenregistrer ce qui l’est chaque jour dans la presse, à la télévision et à la radio. Mais j’en suis, comme tous les Français[,] hanté. Une bombe placée devant une école juive n’a de nouveau pas éclaté – mais on se trouve devant un adversaire innomé autant qu’innommable (encore qu’on sache bien de qui il s’agit), aux acteurs démultipliés qui, en dépit des mesures de protection prises par le gouvernement, peuvent frapper n’importe où, n’importe quand. S’y ajoute le désespoir des jeunes maghrébins qui ne font rien, pour qui on ne fait rien, le chômage ne frappant pas que les banlieues où vivent tant bien que mal des jeunes français qui, étant d’origine algérienne, ne sont pas des Français comme les autres… et qui se sentent compromis par ceux qui, parmi eux, ne sont pas innocents…
… Et tant à dire aussi sur la reprise par Chirac des essais nucléaires français à Mururoa qui, si explicables qu’ils puissent être, sont dénoncés, rejetés, honnis non pas seulement en Australie et en Nouvelle-Zélande – mais dans le monde tout entier.
Je note cela par acquit de conscience pour qu’il en demeure une trace si maladroite et hâtive qu’elle soit. Je suis disons, moins bien (beaucoup moins bien sinon plus mal) ces jours-ci. Me lis avec difficulté à mesure que j’écris…
Ce quai de Béthune me réussit moins bien que Goupillières.
… Systématiquement effacée, gommée sinon minimisée et tout à fait passée sous silence la quotidienne terreur algérienne à nos portes mêmes, si grande aussi la guerre de Bosnie à laquelle l’ONU tente en vain de mettre fin en y glissant elle-même peu à peu… Les États-Unis ont beau avoir enfin décidé d’intervenir [ils] sont rendus impuissants par leur puissance même dont ils ne peuvent user.
Je ne peux continuer. À quoi bon exposer ce que l’on n’a pas la force de maîtriser, tout au moins dans l’expression.
… Je réussis à peine à relire ces pages qu’il ne peut donc être question de corriger et d’améliorer… et suis exténué après avoir rédigé à toute allure, comme pour ne pas tomber, ces pages que je relis si lentement.
Dimanche 17 septembre 1995. – Rêvé de Bruno jeune, beau, en pleine forme comme il était dans sa première puis sa longue jeunesse, devançant ses parents et peut-être les miens. Ils marchaient, comme dans l’allée centrale d’une église et j’essayais d’échapper à leur regard. Je me cachais.
Mon départ du jury Médicis n’a toujours pas été annoncé. Afflux des livres trouvé à la rentrée un peu calmé. Premiers échos. Première liste des noms retenus. En moi, hier – et encore ce matin – mon éloignement proche de la répulsion. Soulagement de me sentir à l’abri mais crainte, si je publie le T.a. 4[,] d’être de nouveau concerné, contaminé. Je me demande si la satisfaction de publier ces pages et celles-ci vaut de me retrouver plongé dans cet, cette… je cherche le mot qui ne serait pas trop malséant tout en étant suffisamment sévère. Marécage… Il est si reposant de se trouver hors course, sans lien avec les auteurs dont on parle – toujours les mêmes et qui le méritent sans doute – et ceux qui ne sont pas autant rejetés qu’oubliés. Hors d’une course à laquelle je ne participe plus ni comme concurrent ni comme arbitre.
Il faudrait avoir la sagesse de ne pas me remettre dans cette mêlée. Je l’aurais, probablement. Ce qui me donnerait, ici, plus d’une liberté dont j’ai déjà tendance à trop user. Liberté, dans une œuvre posthume[,] d’avouer le plaisir que j’ai à évoquer, à citer les témoignages des lecteurs qui m’arrachent à mes doutes, à mon désenchantement de moi-même…
Ces derniers jours encore, reçu un désarmant salut.
[lettre d’Armelle Deroche du 1er août 1995]
D’éventuels lecteurs jugeront si j’ai eu cette sagesse[,] cette prudence ou pas de remettre la publication du T.a. 4.
Prudence, oui, car pourquoi ne pas éviter les coups. Ces injures de certains critiques, ces silences des autres, la non-qualification de la plupart, fussent-ils, en principe, les plus honnêtes, dans l’impossibilité matérielle où ils sont de lire vraiment en une semaine les livres qu’ils ont choisi de commenter, [fussent-ils] bien moins volumineux que le mien.
Lundi 18 septembre 1995. – Tout est relatif, mais si embuée que soit cette page blanche j’écris mieux que je ne lis. Quelques articles en étroites colonnes – avec ou sans loupe, oui. Mais un livre, non, hélas. Je viens d’essayer avec le Journal IV de Charles Juliet dont j’avais oublié si je l’avais vraiment vu. Mais lu, non je ne pouvais pas (encore qu’il soit de mars 94) où je croyais avoir le temps de [le] lire à son heure, comme tant de livres intéressants que j’avais reçus. Je n’ai pas pu, ce soir, et je le regrette car j’admire et aime cet homme en prise directe, dans l’angoisse, avec l’essentiel toujours. Angoisse dont l’écriture l’a, autant qu’il pouvait l’être, sauvé… Inutile d’insister. Ayant essayé d’éviter une vraie sieste, j’avais surmonté toute la journée et j’essaye en écrivant ceci, à tâtons en moi aussi, de me réveiller.
J’exagère, un peu, sans doute. Il m’est de plus en plus difficile de coller à l’exacte réalité que je me propose de décrire. Trop fatigué pour cela.
Voici un journal que je n’aurais pas écrit si je n’avais décidé, hier ou cette nuit, de sa non-publication. Tout au moins de mon vivant. Encore faudrait-il nuancer, peut-être. Mais je suis décidé, aujourd’hui, à ce silence, rompu seulement, comme ici, de moi à moi.
Du coup la publication du T.a. 4, achevé, auquel je n’aurais rien à changer demeure de nouveau possible. Yves Berger vient justement de m’appeler, en réponse à ma longue lettre de Goupillières où je lui apprenais l’existence définitive du T.a. 4 et celle, possible un jour, du T.a. 5. Il s’en est déclaré enchanté. Je l’ai cru. Son amitié, même feinte (ce qu’elle n’est pas tout à fait) est communicative.
Je lui ai demandé qui me remplaçait au Médicis. Il m’a dit : « Personne. Ils y ont longtemps réfléchi, débattu. On ne remplace pas Claude Mauriac »… (sic). C.M. dont je vais finir par me persuader qu’il existe. J’en ai eu quelques preuves récemment. L’attention d’un Régis Debray (je ne l’aurais pas cru).
(L’équilibre d’un jury est si fragile que c’est la vraie raison, probablement, de mon non-remplacement.)
Je crois sage de ne pas continuer. J’essaye de me relire. Redisons que ce n’est pas facile. Mon œil se brouille. Il faut y arriver, pourtant.
… J’ai relu. Il suffit que j’écrive un journal pour que je retrouve le goût de la vie. Et j’ai à peine le désir de la publication[,] pourquoi pas…
Intuable homme de lettres…
Mercredi 20 septembre 95. – Je suis moi-même étonné de cette quasi-transfusion sanguine qu’est pour moi le journal lorsque je parviens à m’arracher de mon fauteuil vert où la radio m’endort lorsque je ne lis pas, faute de livre, un journal. Sans doute cela est-il connu – vécu par les écrivains et, parfois, peut-être, à un âge moins avancé. Il faut que je me le dise pour ne pas trouver moi-même ridicule le recours salvateur, si bref soit-il, à l’écriture. En faire le sujet d’un journal, y revenir, me le répéter, ajouterait à ma gêne, si je n’avais pas, en principe, décidé de ne pas publier ces pages.
En principe…
On ne sait jamais avec un homme de lettres…
Jeudi, 21 septembre 1955. – 1 h. Trop de livres. Trop de papiers. Trop de dossiers. Plus de place. Mobilité et vision réduites. J’ai perdu le contrôle sans pouvoir espérer le retrouver jamais.
Marie-Claude ajoute à ses multiples charges la responsabilité de toutes les affaires administratives dont surtout celle des impôts. Nous ne trouvons chaque fois l’argent que par miracle. Le mot est à peine trop fort.
Vendredi 29 septembre 1995. – Appel de Nathalie Sarraute à qui j’ai écrit pour la remercier de nous avoir envoyé Ici dont le succès critique est considérable. Elle a 95 ans et nous l’avions trouvée relativement peu changée dans le film que vient de lui consacrer F.R. 3 – où elle est admirable de simplicité, de rigueur, d’intelligence, de beauté. Et là, au bout du fil – comme on dit, mais qui est aussi le long fil du temps (il y a des années que nous lui avons rendu visite pour la dernière fois) la chaleur retrouvée, de sa voix – la moindre de ses intonations aussitôt reconnue. Ce n’est pas en ce moment que je l’entends ou plutôt ce moment est celui une fois pour toutes fixé, vivant de ce que fut et qui demeure notre amitié pour elle – et la sienne pour Marie-Claude – pour moi.
« C’était vraiment le temps immobile » me dit Marie-Claude qui lui avait répondu la première. Le temps immobile, oui, non pas littéraire mais attaché à notre mutuelle affection, comme à tant d’autres passés-présents surpris pareillement au hasard des rencontres.
C’est pourquoi il ne nous manque pas l’ami que nous ne voyons plus et dont seules la mort de l’un et de l’autre éteindra le rayonnement, la plus ou moins vive lumière – ou la pâle lueur subsistante. Ils sont là, en nous et nous pouvons, parfois, comme lors de cette conversation avec Nathalie Sarraute, les approcher avec étonnement, joies et remords. S’il est mort, cet ami, et si nous l’avons aimé, il vit en nous où sa présence est aussi peu dubitative que lorsque nous le savions à portée de voix, tout au moins, si nous en éprouvions l’envie. Mais il est attristant de découvrir aussi combien facilement nous nous en passions. Si peu enclins que nous soyons à nous aimer nous nous suffisons à nous-même. Un nous-même si fugitif que nous éprouvons parfois le vertige « de douter au sein de l’être même, de son existence ».
(Vécu le 21 septembre [sic] mais enregistré ici en cette fin de journée du 2 octobre.)
Notes de cet été retrouvées :
Tout cela a été mal dit, tout cela serait à récrire. Et c’est pourquoi nous écrivons toujours le même livre…
… la moustache raide et piquante de mon père sans âge.
Jeudi 5 octobre 95. – Départ de Gilles pour Tokyo.
Paris, vendredi 6 octobre 1995. – Saint Bruno. – Alors que nous nous y attendions d’un jour et désormais d’une minute à l’autre, coup au cœur physique de la mort de Bruno. Coup au corps.
Samedi 7 octobre 1995. – Comme, depuis longtemps, je ne le voyais presque plus jamais, Bruno habitait mon passé où, vivant, il habite toujours.
Dimanche, 15 octobre 1995. – Je souhaite à la fois écrire un journal pour m’arracher à une torpeur qui commence à m’inquiéter et ne pas parler ou le moins possible de ce qui nous a accablés, oppressés ces jours-ci.
Bruno si proche et si lointain, tel qu’il n’était plus que pour quelques heures, pareil à lui-même et pourtant si différent. Lui et un autre. Au premier regard je fus presque rassuré. Mon appréhension avait été plus pénible que le face-à-face. Un mort comme les autres. Plutôt moins impressionnant que ceux dont le visage de marbre m’avait, au-delà de tout chagrin, effrayé. À peine différent de celui que je lui avais connu. Luce, Arnauld qui l’avaient vu au moment même où il venait de mourir, m’avait parlé de sa paisible beauté. Rien de tel, déjà, aux lèvres près, allongées, rétrécies. Son visage de toujours, hors du temps…
Je ne veux rien évoquer, rien raconter – Sa fille Catherine, que je n’avais vue qu’une fois, enfant, à Vémars, et qu’il me semblait connaître, aimer depuis toujours. Son fils Arnauld lové dans les bras de Jean. Bertrand au prénom si lourd à porter pour les quelques survivants d’autrefois. Anne dont je me sentais si proche – alors qu’elle ne fut pas telle, jamais, pour moi. Pour nous. Je la serrais contre moi. Ma canne dans ma main droite m’empêchait d’étreindre Luce – ma sœur bien-aimée dont la présence, l’attention, et le seul fait pour moi de la sentir, de la voir là, dans sa bonté et sa simplicité…
J’en ai déjà trop dit. Les prières d’un prêtre émouvant de naturel dans le surnaturel même…
La fatigue d’un journal trop long s’ajoute à celle qui m’oppresse ces jours-ci. Il ne faut plus m’attarder à ce qui exigerait, pourtant, toute ma concentration, si je veux avoir la force – voyant de surcroît si mal… – de dire ce pourquoi, surtout, je voulais écrire ce journal.
… Bruno, le visage figé de Bruno, me hantait dès que j’en fus éloigné. Photographié en moi, alors que s’effaçaient très vite non pas les visages de mon père, de ma mère mais la frayeur qu’ils m’avaient donnée. Et depuis longtemps déjà, mystérieusement, ils ont perdu en moi toute virulence – au point même que je dois faire un effort pour essayer de les revoir. Alors que Bruno – en ces heures encore si proches il est vrai, est là, gravé (je n’ai pas le temps ni la force de trouver les mots exacts). Blessure non cicatrisée, ni cicatrisable, peut-être, mais immobilisée, figée, durcie en moi. (Ce ne sont pas les mots qu’il faudrait…)
Vu une fois de plus, sans émotion, dans un bonheur paisible, mon père au cours d’une émission de télévision. Toujours étonné de n’être pas étonné. De le voir, de l’entendre comme s’il était là, il est là. Si élégant, avec me dit Marie-Claude quel que soit le propos (ici Maurice Barrès) laissant affleurer sous le brillant, la drôlerie, une gravité, une profondeur, des profondeurs intenses mais rayonnantes, paisibles.
J’ai noté aussitôt ceci que me dit Marie-Claude et qui est d’une telle justesse, à propos de ces images qui me le découvrent plus vrai, sans doute, que dans le direct de la vie. Quoi qu’il dise « il irradiait chez lui quelque chose d’autre… ».
L’image de Bruno, en moi, ne laisse rien sourdre de ce qu’il était. Elle me fait mal. Au chagrin que je me reproche de ne pas avoir, se substitue cette douleur où ce n’est plus de lui qu’il s’agit, de lui à jamais arraché à la vie et à nous – l’à jamais si bref qui me reste, mais égoïstement, de moi.
Il faudrait dire aussi son nom, Bruno Gay-Lussac, prononcé – grâce à Marie-Claude – par notre curé, le père Jean Laverton, au cours de cette messe à Saint-Louis-en-l’Isle, jeudi 12 octobre, le soir même du jour où, selon sa volonté, Bruno avait été incinéré puis inhumé à Vémars. Je ne l’aurais pas supporté, la fumée monte toujours au dessus de nous de ce qui avait été Jean Davray…
… Depuis, Michelle Maurois, près de qui, assis sur une tombe, j’ai vécu cela, est morte, elle aussi.
Nuit du 13 au 14 octobre. – Bertrand et Bruno, morts l’un et l’autre, nommés ou présents, dans le même rêve.
Mardi 17 octobre 95. – Nouvel attentat RER Orsay-St Michel.
Paris, samedi 21 octobre 1995. – Encouragé par la première visite de Jacky Bertrand, mon correspondant de cet été, déraisonnablement fasciné par « mon œuvre », et par l’attentive amitié de José Cabanis qui non content d’avoir relu avec satisfaction son propre choix m’annonce qu’il va reprendre Le Temps immobile depuis le premier volume…
… j’ai pour la première fois depuis les épreuves commencé à lire le T.i. 1 depuis la première page… Avec les surprises d’une découverte…
Mercredi 25 octobre 1995. – Une fois encore, écrire pour lutter contre l’engourdissement. Mais je vois particulièrement mal ces jours-ci. Autres handicaps (tout ceci à barrer si je puis monter un jour le T.a. 5) fatigues extrêmes, malaises divers, marches pénibles de 20’ tout au plus…
… et surtout ces sommeils qui me prennent d’un coup plusieurs fois par jour – ou alors, pire si possible parce que la récupération de l’endormissement ne survient plus – cette torpeur à la fois accablante et lucide. Mon esprit présent dans la nuit mais sans que soient liées mes fugitives impressions.
Je me proposais d’écrire un long journal car j’ai beaucoup à dire sur ce que m’ont rappelé, révélé les premières pages du T.i. 1. L’œuvre à écrire obsession de ma vie tout entière depuis l’adolescence mainte fois enregistrée, les dates découvertes une à une, dans le désordre, et les journaux correspondants montés dans Le Temps immobile 1. Plus précise (je l’ai noté… mais même avec une loupe je ne peux me relire)… « Œuvre » qu’à la fin des fins je croyais avoir commencée, puis accomplie – même si je n’en étais que relativement satisfait, avec mes premiers romans, T.L.F.S.F., Le Dîner en ville, La marquise… Avec, remontant très loin dans le temps, et parfois dans ces romans mêmes, la première, les premières lueurs de ce qui deviendrait, un jour, Le Temps immobile – ce que je fus stupéfait d’avoir avec le T.i. 1 réalisé enfin. Je peux lire, à l’encre et non plus au crayon invisible : T.i. 90-105. Et pp. 84-85 de l’édition Grasset, l’intuition déjà précise le 18 juillet 1943 (après ma découverte de Joyce des années avant) de ce qui serait « le nouveau roman », tel que, moi, j’en sentais déjà la nécessité et en entrevoyais les possibles accomplissements. Esquisse. Dessein d’où naissaient des dessins, déjà. J’entrevoyais, oui, ce que nous étions q[uel]q[ues]-uns à chercher alors. Faute du minimum de moyens physiques (choisir, découper, photocopier, monter) je ne puis ne fût-ce [que] fragmentairement insérer ici ce qui, autrefois, du T.i. 1 aurait glissé ici dans le T.a. 4.
Cette œuvre, je dois bien admettre que je l’ai réalisée dans toute la mesure de mes capacités. Et que le résultat n’est pas si décevant si j’en crois tant de témoignages – dont ceux de José Cabanis au dos des photos de son parc de Nollet presque chaque semaine…
Avec, hier, cette émotion dont je ne me remets pas. Je reçois du Seuil (dans la collection où il y a si longtemps a paru mon Proust) deux volumes d’un Dictionnaire des écrivains français par Jean Malignon.
Je savais que je ne m’y trouverais pas et en éprouvais déjà la tristesse, lorsque à la lettre M de l’index je tombais sur deux Mauriac – alors que je n’en attendais qu’un… Mon émerveillement fut encore plus intense lorsque en me découvrant après Maupassant je mesurai combien avait été exigeante la sélection des auteurs cités – choix personnel, ce dont convenait Jean Malignon, ainsi précisé : « … l’auteur veut inviter à lire et à découvrir les œuvres les plus caractéristiques aussi bien chez les écrivains de “plus large public” que du côté de “l’avant-garde”. » Sur mon père la notice est d’une compréhension, d’une admiration, d’une liberté qui l’aurait comblé (et qui me comble), le poète qu’il souffrait de ne jamais voir accueilli, y étant célébré.
Sur moi…
… ce qui m’avait fait autrefois un si grand plaisir sur mes premiers romans qui ne m’intéressent plus guère, mais aussi, plus constant (il faut du temps pour composer un tel dictionnaire), Le Temps immobile « qui restera sans doute, son plus beau titre de gloire… » (sic !).
Sans me laisser impressionner par le nom de Mauriac et l’œuvre de mon père si admirée, si aimée par moi, j’ai suivi mon petit chemin sous mon nom, avec mon prénom. Pour en arriver, me dit Marie-Claude, à cette consécration dont je ne reviens pas : nos deux noms rapprochés dans un dictionnaire (17 h 30-18 h 30).
Jeudi 26 octobre 1995. – 18 h 30. N’importe qui pourra avec facilité établir cette chronologie à laquelle j’ai dû renoncer hier. Toutes les dates, depuis les plus anciennes, figurant dans le premier chapitre du Temps immobile 1. J’aimerais pourtant en avoir sous les yeux les dates qui marquent la naissance d’une ébauche d’idée du 18 juillet 1943 à l’accomplissement de l’été 1972[,] avec de longues interruptions, des reculs, des doutes, des espoirs retrouvés d’aboutir enfin à ce volume[,] qui serait peut-être le seul mais qui répondait enfin à ma très ancienne exigence d’accomplir l’œuvre dont je pressentais en moi l’être en formation, incertain, indécis, mais palpitant, vivant[,] qu’en dépit de toutes les déceptions, de si nombreux retards, cette certitude que j’avais une œuvre à accomplir l’emportait sur toutes les raisons que j’avais peu à peu de ne plus espérer réellement jamais ce montage de petits blocs de temps[,] qui une fois l’œuvre édifiée niait le temps alors même qu’il le rassemblait.
J’écris de nouveau pour échapper aux torpeurs et engourdissements qui, depuis quelques jours, se précisent et m’inquiètent. Je suis trop fatigué, je vois trop mal pour composer un vrai journal. En écrivant cela je cours sur le vide pour ne pas tomber. Plusieurs fois par page je sens, je sais que le mot que j’emploie n’est pas celui qui correspond à ce que je veux exprimer. Si je m’interrompais pour le chercher je vacillerais, et risquerais la chute dans un silence dont je n’aurais plus la force de sortir. D’où ces pages inutilisables qui ne pourraient figurer dans le T.a. 5 que si je les reprenais à tête reposée. Mais tel n’est pas le repos où ma tête glisserait si je levais la plume. Seule raison d’être de ces pages : surmonter autant que je le puis au prix d’un effort de chaque seconde l’engourdissement cérébral auquel je voudrais échapper et que j’aimerais vaincre. Mais est-ce possible à mon âge ?
Seul intérêt de ces notations : garder une trace (mais pour qui ?) de ce qui est peut-être l’amorce d’un ensevelissement vivant définitif. Mais peut-être pas. Je me dis parfois, sans trop y croire, qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise circulation cérébrale, mais peut-être une conséquence, entre autres, de la faiblesse persistante.
… c’est à peine si je peux, en gros, me relire.
La sagesse serait d’interrompre jusqu’à ce que, qui sait, pourquoi pas, je n’y compte pas, une vision suffisante, une suffisante présence intellectuelle me permettent de reprendre…
… illisible –
|
|