 |
||
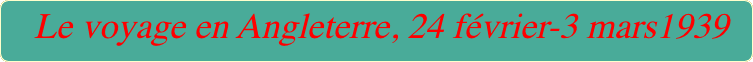 |
||
Au début de 1939, François Mauriac est invité à Londres pour la première représentation, en anglais, de sa pièce Asmodée. Il s’y rend avec Jeanne son épouse en février. Claude accompagne ses parents. À cette époque, il écrit quotidiennement son Journal. Avec lui, suivons cette équipée. Ce journal est inédit, sauf les passages concernant la famille Bodley, et notamment l’amour d’enfance de Claude, Pasy Bodley. (Tous droits réservés). |
|
Vendredi 24 février [1939]
Départ de la gare du Nord à 10 h 1/2 dans la Flèche d’Or qui, pour mon enfance habituée aux omnibus de Survilliers, avait un tel prestige. Papa a un air malheureux et méfiant qui nous fait bien rire. Maman consulte avec gourmandise des plans de Londres où elle se rend pour la première fois… Déjeuner au wagon-restaurant. Nous sommes les seuls Français et Boulogne, où nous arrivons à 1 h 1/2, a déjà l’air d’une ville anglaise. Je retrouve les mouettes et l’eau sale d’un port, mais ce n’est plus Tunis. Un vent glacé et quelque peu tragique me met au cœur une certaine nostalgie. Inconfortable voyage, mais si bref que le mal de mer n’a pas le temps de se manifester. Un incident comique, mais qui fut plus éreintant à vivre qu’une tragédie marqua notre arrivée à Folkestone. Au moment de débarquer et alors que la surveillance de nos bagages et notre ignorance de l’anglais nous donnaient déjà assez de sujets d’inquiétude, maman disparaît mystérieusement. Papa qui est aux limites de la fatigue, est d’abord ennuyé, puis furieux, puis affolé. Le bateau se vide… Impossible de trouver maman. Mon père court au hasard à droite et à gauche, ayant absolument perdu la tête, et son agitation insensée d’abeille prisonnière m’étonne car je ne vois pas ce qu’il peut y avoir de grave dans ce contretemps. Mais cette disparition est si étrange, elle s’est produite si soudainement, l’inquiétude de mon père atteint un tel paroxysme, que je commence bientôt à être gagné moi-même par un commencement de panique ! « Elle est peut-être tombée à l’eau… Mais que faire ? Qu’allons-nous faire ? » Je n’avais jamais vu papa ainsi affolé. Il allait, le visage écarlate, au hasard, en faisant de grands gestes… (Lui qui nous avait recommandé un flegme et une discrétion, seuls compatibles avec le goût anglais !) Dans un anglais approximatif, je me renseignais, mais personne n’avait vu la « french lady ». Ce qui compliquait la situation, c’est que mon père possédait tous les papiers de maman. Et, si nous ne l’avions pas vu débarquer, elle n’était pas à bord non plus. Nous nous résolûmes à descendre. Les bagages avaient disparu dans l’affaire. Nous nous mîmes à leur recherche… et les trouvâmes à la douane, ainsi que maman qui « était partie seule, telle une flèche, à l’aventure. Étrange attitude qui lui est habituelle », dira papa. Pour le moment il crie d’une voix courroucée son inquiétude. Chacun regarde ce Français gesticulant, je suis gêné au possible… Papa est maintenant d’une pâleur extrême. « … C’est bien la dernière fois… On ne m’y reprendra plus… » Douane. Les valises qu’il faut ouvrir sont naturellement celles qu’il est le plus difficile de refermer. Après quelques nouvelles fausses alertes, nous nous trouvons assis dans un pullman, exténués… Banlieue anglaise sordide et pathétique, comme dans mes rêves. Puis vertes prairies où les moutons sont de grosses touffes immobiles et laineuses. Le sens du ridicule nous revient peu à peu. Nous rions de nous-mêmes. (Je pense pourtant que seul je ne me serais pas inquiété, et qu’un peu de réflexion eut tout arrangé. Mais mon père ne supporte pas la moindre contrariété. Je me demande ce qu’eut été sa vie, et sa réputation, si le talent et la gloire ne lui avait donné toute licence de s’abandonner à ses nerfs.) Papa a un peu honte de s’être laissé aller. Il rit gentiment de lui-même. Il dit : « À Londres, je sortirai le moins possible de ma chambre… » Il dit cela pour rire, mais au fond il est sérieux… Jenny de Margerie nous attend à Victoria Station. Son auto nous mène d’abord 113 Eaton Square, chez elle, où j’habiterai. Mes parents doivent y prendre le thé avant d’obtenir la permission d’aller au Park Lane, qui est leur hôtel. J’ai une petite chambre très simple, sans eau courante et glacée. L’extraordinaire politesse des maîtres d’hôtel en habit qui viennent sans cesse, à ma grande stupéfaction, demander : « Monsieur a besoin de quelque chose… ; si monsieur veut être aidé pour s’habiller », ne rachète pas tant d’inconfort. J’aurais évidemment préféré être avec ma famille. Ici je ne suis pas chez moi. Au lieu de me reposer, il me faut demeurer au salon avec Jenny de Margerie, et François Valéry qui est là : et des visites arrivent, et mon ignorance de l’anglais m’humilie… Jenny est charmante […]. Je la comble en lui disant qu’elle passe à Paris pour la reine de Londres. Mais elle revient avec une orgueilleuse humilité sur les gens qui ne savent pas ce qu’elle est et ne le veulent pas savoir. […] Son mari qui est le Conseiller d’Ambassade ici, oppose à son effervescence un calme résigné. On sent qu’il a renoncé à l’exaspération…
Une petite salle aux allures clandestines, le Gate Theater, reçut l’adaptation que Sir Basil Bartlett a faite d’Asmodée. Lady Bartlett nous accueille, et je retrouve son charme qui me frappa tellement un jour de l’été dernier à Malagar. Nous sommes, papa et moi, les seuls hommes en habit. (Une raison de plus d’être gêné, cet oubli lamentable qui nous fit laisser nos smokings à Paris…). Avec une mise en scène très simple, sur un plateau minuscule, Asmodée m’apparaît décantée, plus proche du texte original que l’interprétation de la Comédie-Française. Ma connaissance rudimentaire de l’anglais, ma connaissance parfaite de la pièce s’épaulant, je suis fort bien d’un bout à l’autre, et si parfois je perds le fil, un mot me remet bientôt à flot. Coutûre, qui s’appelle ici Lebel, à cause de la difficulté de la prononciation, est joué par un acteur beau et jeune qui me paraît beaucoup plus compréhensible, mais moins compréhensif, que Ledoux, qui semble laid et vieux, bien qu’il soit jeune et non dénué de beauté. Ce Wyndham Goldie arrive à être assez atroce et assez séduisant pour que l’on comprenne à la fin la répulsion, et surtout l’attrait qu’il exerce sur Marcelle de Barthas. Celle-ci est interprétée par une femme encore très jeune, Mary Hinton (qui est de sang royal ! Mystères de l’Angleterre !). « Mademoiselle » est jeune elle aussi, et l’actrice qui joue Emmanuelle, Joyce Redman, est plus jeune que Casadesus ou Faure. Ce décalage rend la pièce plus vraisemblable, plus pathétique. La sobriété de la mise en scène et la perfection du résultat obtenu montrent bien où est la voie du théâtre, contrairement aux théories actuelles de la Comédie-Française. Je suis ému comme au premier soir. Larmes dans la salle attentive. Gros succès à la fin. Papa est assez ébloui : sa pièce l’a ému dont il ne comprenait pas un mot mais retrouvait l’esprit.
Souper chez les Margerie. Le champagne me remonte un peu. Un tas d’Anglais inconnus. Le critique Mortimer, qui est un ami de mon père. Tous les acteurs. Michel Brousse (qui est en séjour à Londres). La trépidante Jenny, impitoyable, ne laisse pas à mon père une minute de paix. Il mourait de faim. Il ne peut dîner… À 1 h, j’obtiens de Jenny la permission de me retirer. Il n’y a plus au salon que quelques fanatiques.
Londres, samedi 25 février [1939]
On me réveille à 10 heures, après une excellente nuit où je me suis adorablement reposé, malgré un froid torturant. Promenade seul jusqu’au proche Piccadilly. Les autobus rouges, spirituels avec leurs deux étages, sont la seule note gaie d’une ville qui me paraît d’une dignité tout à la fois désagréable et prestigieuse. Green Park et ses vergers de pleine campagne m’attire… À l’hôtel Park Lane je trouve mes parents… Ils sont très apeurés par Londres. Papa est mécontent de dépenser tant d’argent pour être si mal (son petit déjeuner lui a coûté avec le change 45 f. français). Maman et lui qui sont habitués à l’aisance d’un grand appartement doivent se faire l’un l’autre de gênantes concessions. Leur ignorance de l’anglais leur ôte toute joie. Ils n’ont plus qu’une idée : échapper à ce dépaysement atroce, retrouver Paris. Londres revêt au contraire pour moi un extraordinaire prestige, malgré tout ce qui m’y heurte. Déjeuner chez les Margerie avec François Valéry et Michel Brousse. François m’exaspère, comme autrefois, par sa sévérité universelle pour autrui, son indulgence pour lui-même, et ces partis pris de superficialité et de nonchalance qui lui sont habituels. Roland de Margerie me parle avec beaucoup de brio des erreurs de la politique de Munich. Domaine où Jenny n’ose pas s’aventurer. Lamentable promenade sous la pluie avec le petit Brousse. Un métro d’une complication monstrueuse nous amène dans la City où, sous l’averse, nous apparaissent la Tamise, le fameux pont, la tour… Le fleuve coule entre deux rangées d’immenses grues, survolé de mouettes et d’appels marins : les sirènes des bateaux achèvent de donner à ce paysage pluvieux un tragique de roman réaliste. Marche sous l’averse dans des quartiers sinistres et déserts. Thé dans une pâtisserie de Piccadilly. Nous passons à l’hôtel : mes parents, qui viennent de déjeuner avec les Bartlett, m’y apparaissent accablés de mélancolie, de fatigue et de déception… Chez les Margerie. Je me change et m’apprête à lire tranquillement lorsque le valet vient de dire que « Madame est rentrée et qu’elle m’attend ». Il me faut donc aller au salon où je trouve Jenny et François. Inutiles conversations jusqu’au dîner où vient Roland qui part bientôt après. Je suis assez brillant. Jenny a l’air contente de moi. François allait au cinéma, je passe la soirée avec elle : elle est bientôt beaucoup plus spontanée et simple. Elle ne cherche plus à m’éblouir par ses connaissances philosophiques, mais me parle de ses enfants, de l’École des Roches où ils sont, de l’égoïsme de classe des gens du Crédit Lyonnais (étonnant dans sa bouche !), de son frère Alfred Fabre-Luce qu’elle juge assez sévèrement (« Il écrit toujours un ton au-dessus de ce qu’il devrait. Il prend la voix de Benjamin Constant. De quel droit ? »). Sa confiance, sa spontanéité me touchent. Je m’aperçois qu’elle est fine et intelligente, et elle m’apparaît naturellement telle au moment où elle ne pense plus ni à être intelligent ni à être fine !
Londres, dimanche 26 février [1939]
Papa est malade : crise de foie s’ajoutant à un rhume recrudescent. Les Bartlett nous emmènent, maman et moi, dans leur voiture. Le temps est d’une douceur printanière. Longue sortie de Londres. Hyde Park, puis Richmond Park et ses cerfs apprivoisés. La vieille ville de Richmond avec ses adorables maisons. Aux limites du Sussex une campagne paisible où une auberge qui sent bon nous accueille. L’Angleterre commence à m’apparaître revêtue d’une bien prestigieuse beauté… À Londres à 6 h. Goûter avec Jenny et François. Lecture d’un Journal de Charles Du Bos (passionnant). Mon père, à peu près remis après une journée de solitude et de repos, vient dîner avec maman et Edmond Vermeil, le germaniste de la Sorbonne, dont la conversation sur Hitler est passionnante. À l’autre bout de Londres, au Mercury Theater, une salle minuscule, nous allons voir des ballets dont la jeunesse fait le seul charme. Ce n’est pas beaucoup. Rentré à 11 h 1/2. Je lis Du Bos au lit.
Londres, lundi 27 février [1939]
Le capitaine Mc. Ewen, qui est député aux Communes, a traduit Ce qui était perdu. C’est à ce titre qu’il a aimablement offert de nous faire visiter ce matin le Parlement. Après nous avoir montré la sobre petite maison, si célèbre ! de Downing Street où habite le Premier anglais (n° 10), il nous fait entrer au Parliament. L’édifice récemment construit en style néo-gothique est pourtant imprégné d’une vénérable ancienneté. Tout le passé est là, présent dans ces nouvelles pierres. Voici la Chambre des Lords. Elle fait, le matin, fonction de cour d’appel : aussi y voyons-nous quelques juges en perruque. Ils parlent gravement et, bien qu’il n’y ait aucun public mais les seuls avocats et huissiers nécessaires à la marche du procès, une implacable dignité les accable. La Chambre des communes est plus émouvante. Le journal du matin annonçait que M. Chamberlain devait y parler l’après-midi même, pour expliquer aux députés pourquoi la Grande-Bretagne devait, en même temps que la France, reconnaître Franco… Il est une heure. C’est donc dans deux heures que doit avoir lieu cette mémorable séance. C’est là, dans cette pièce rectangulaire, à l’air sage et grave que se sont aussi déroulés jadis tant d’émouvants spectacles. Et je ne puis imaginer vraiment cela. Ce coquillage vide, comment pourra-t-il jamais retrouver l’existence, et dans si peu de temps ! Une atmosphère d’éternité règne ici. Que M. Chamberlain doive s’y trouver dans quelques instants pour y évoquer les plus pathétiques problèmes de l’actualité me paraît aussi stupéfiant que si Cromwell devait y venir… M. Mc. Ewen nous fait maintenant visiter Westminster Abbey… Très ému par ces tombes rapprochées, simples dallages sur lesquels on marche : Dickens, R. Kipling, Th. Hardy, et les plus grands poètes sont là, côte à côte… Une petite rue aux vieilles maisons de briques roses. Mrs. Mc. Ewen nous reçoit. C’est une fraîche et jolie jeune femme dont la simple affabilité, comme celle des Bartlett, m’émerveille. Son mari est discret, silencieux, méditatif. Un amour passionné de la France éclaire son visage. Il dit avec une simplicité charmante qu’il n’est pas un député bien remarquable, qu’il ne fut pas un diplomate très brillant… Le déjeuner est sobre, mais bon. Mon père se sent chez lui. Il est détendu, heureux d’être remis. Au dessert, il ne résiste pas et prend avec une imprudence d’enfant du chocolat et de la crème fraîche.
La National Gallery m’émerveille et me désespère. Un tel amoncellement de chefs-d’œuvre est décourageant. Je retrouve pourtant cette paix miraculeuse que seuls me donnèrent certains Italiens, et c’est Carpaccio, et c’est Bellini surtout qui me font de nouveau connaître la quiétude bouleversante d’autrefois… Jamais spectacle ne me stimula autant qu’une exposition de maîtres italiens. Je sors de la National Gallery dévoré d’un lancinant appétit intellectuel. Le besoin de créer me tourmente. Je ramène mes parents au Park Lane, puis rentre, toujours à pied, chez les Margerie. Là le Journal de Charles Du Bos étanche ma soif. J’y trouve un peu de cette richesse dont j’ai tant besoin… Mais il me faut retourner bientôt au Park Lane. J’y vais par ces rues déjà familières. Au ciel de Picadilly, un projecteur bleu fouille le ciel, et j’évoque les nuits menacées de Prague, cet été. Je pense aussi à ces parcs de Londres bouleversés, tels que je les vis ces jours-ci : les Anglais, pris de panique en septembre, y ont creusé de profondes tranchées pour s’y abriter en cas de bombardement… « … On comprend le mécanisme de la politique hitlérienne, dit mon père. En face de ce pays comblé, de cette civilisation miraculeuse de richesse et de raffinement, Hitler est le monsieur qui se présente, une mèche allumée à la main… Les Anglais ne veulent pas sauter. Les Anglais ne veulent pas perdre leur fortune, leur bien-être… Les Anglais céderont tout … » Dîner au Park Lane avec mes parents et Michel Brousse, heureux de retrouver un peu de famille. Palace aux musiques doucereuses qui évoquent pour moi cet avant-goût de l’Allemagne charmante, non celle d’Hitler, mais l’éternelle Allemagne de l’amour et des danses, telle que le pays des Sudètes, et ce village du Tyrol en janvier, me l’ont fait connaître… Nous parlons peu. Au salon, notre silence se fait plus épais encore, mais aucune gêne ne l’accompagne. Michel m’emmène boire un verre dans un gigantesque Lyon’s. Londres, la nuit, garde, malgré la débauche des lumières, un air sage qui m’inquiète. Michel n’a rien à dire. C’est un adolescent sans intérêt, mais charmant.
J’ai oublié de noter cette brève promenade solitaire à Hyde Park, ce matin. Des cavaliers galopaient dans la longue et large allée qui fuyait au cœur d’une brume ensoleillée. Des enfants se poursuivaient en riant. D’autres offraient du pain à des pigeons, parmi lesquels de nombreuses mouettes se mêlaient. Le soleil brillait dans un ciel pur. C’était là l’image d’un luxe délicat, prestigieux, terrible… Je pensais sans épouvante mais avec remords à la misère du monde.
Londres, mardi 28 février 39
Journée hantée d’un vertige si grave qu’il n’est même pas question d’en souffrir : il me jette au-delà du découragement et de la douleur… Au vrai, rien que de très banal là-dedans. Banal comme l’est l’angoisse que met au cœur l’infini palpitant d’une nuit d’été. De cette banalité à laquelle on ne s’habitue pas et qui laisse toujours derrière elle la même épouvante. Le British Museum le matin (et la présence de multiples civilisations surgies du passé), le château d’Henri VIII l’après-midi (Hampton Court) avec la trace vivante d’un règne oublié, furent l’occasion du vertige dont je parle. Au British Museum, devant les frises du Parthénon, nous retrouvons notre stupeur émerveillée de la Grèce : « … Je sens que je vais retravailler à mon Atys », dit mon père pour qui « le miracle grec » a le même pouvoir apéritif que les Bellini d’hier sur moi… Il dit aussi : « L’existence de la grâce avant la naissance du christianisme pose un bien redoutable problème… » Plus loin, en présence des merveilles assyriennes, puis égyptiennes, puis bouddhiques, il murmure : « Comme nous nous sommes débarrassés avec aisance de ces civilisations miraculeuses… De quel droit ? Que tout cela se soit passé alors que le Christ n’était pas encore venu sur la terre, m’inquiète… » En moi, plus qu’une inquiétude. La paix de la certitude. D’une certitude accablante pourtant : le christianisme prend chronologiquement sa place dans la suite des religions ; il n’est ni plus, ni moins (important cela, et peut-être faut-il y voir l’ébauche d’une espérance possible) fondé métaphysiquement que les autres mystiques… Un sarcophage ouvert nous montre le cadavre recroquevillé d’un homme qui vivait en Égypte 3 500 ans avant le Christ. Il s’est momifié seul, par quel miracle ? La peau est desséchée, mais elle est intacte. Le crâne porte encore les touffes rousses des cheveux. Cet être n’est pas beau, mais il a forme humaine… Vision terrible. Mon père a longuement regardé. Puis il a vu des momies, rigides sous leurs bandelettes, au fond de somptueux sarcophages et il a dit, avec tristesse : « C’est étrange… Ces hommes qui pensaient avant tout à perpétuer leur existence dans la suite des siècles donnent la plus probante idée du néant que l’on puisse avoir… » Il ajoute aussitôt : « Ce qui ne prouve rien. » Il a dit quelque chose de semblable, tout à l’heure, après avoir évoqué l’inquiétude où le plongeait la tardive venue du Christ. Comme si j’étais un enfant à qui il ne fallait pas donner des raisons de douter. Comme s’il voulait se persuader lui-même que sa foi n’avait pas à souffrir de ses nouvelles découvertes. Mais moi je ne suis pas dupe. Et je tourne au fond de mon cœur les hommes en dérision : tant d’orgueil et de pauvres ambitions pour aboutir à ce néant… Et je ris de moi-même.
Au Savoy… Une somptuosité qui n’est pas pour moi sans prestige. Un luxe qui me fait de nouveau évoquer la misère avec remords. Mais un secret contentement est le plus fort. L’Honorable Mrs Pitt-Rivers qui, sous le nom de Mary Hinton, joue dans l’Asmodée londonien le rôle de Madame de Barthas, nous a invités à déjeuner. Il y a là la charmante Veronica Turleight, qui interprète « Mademoiselle », son mari, un écrivain qui me paraît fin et intelligent nommé Sandeman ( ?), un auteur dramatique dont j’ai oublié le nom et surtout le romancier Charles Morgan et sa femme. Mrs Pitt-Rivers est belle, avec un noble visage, et j’aime sa grâce de grande dame. Veronica Turleight est ma voisine : mi en français, mi en anglais, elle me parle d’Asmodée avec une émouvante simplicité. Charles Morgan est beau, silencieux, un peu guindé, avec je ne sais quoi de cruel et tout à la fois de doux dans son visage boucané, bien que jeune encore. Mon père le trouve trop prétentieux. Il l’accuse de porter son génie comme le saint-sacrement (il nous le dira plus tard). Aussi affirme-t-il bien haut qu’il passe quant à lui pour être assez bête, ce qui ne l’ennuie pas car un romancier ne doit pas être trop intelligent. (Critique directe à l’adresse de Morgan.) Tandis que se déroule le luxueux repas, je regarde devant moi la Tamise pluvieuse. Un arbre dépouillé occupe tout le ciel de la grande baie vitrée. Un pigeon s’y est posé, petite boule immobile sous la pluie. Des mouettes volent, très haut… Mrs Pitt-Rivers nous emmène, papa, maman, le mari de Veronica et moi, dans sa voiture qu’elle conduit elle-même. Avant d’atteindre Hampton Court, il nous faut traverser Chelsea, puis le parc de Richmond avec ses arbres vénérables et ses troupeaux de cerfs frileusement serrés… Ce palais de briques rouges est sinistre, et pourtant grandiose. Nous le visitons par faveur spéciale après l’heure de la fermeture : un jour pauvre entre par les interstices des rideaux tirés. Les ombres d’une Cour prestigieuse s’agitent dans les salles immenses. Froides, nues, lamentables de tristesse, elles ne sont pourtant pas sans grandeur. Le gardien a l’air équivoque d’un fantôme incarné. Mrs Pitt-Rivers possède une démarche si noble que ce château austère semble à sa mesure…
Elle nous reçoit dans sa minuscule et charmante maison de Chelsea. Joie du thé après tant de fatigue. Maman se repose avec joie ; sa jeunesse fera encore tout à l’heure l’admiration des invités de Jenny de Margerie… Elle donne un petit thé, en effet, et il faut encore nous y rendre avant de pouvoir souffler. Paul Valéry est là, arrivé de ce matin. Il me paraît moins hirsute, plus soigné et en quelque sorte plus ressemblant à un grand poète, que de coutume. Je le trouve beau, pour la première fois. Une sorte de jeunesse illumine son visage ravagé… Repos enfin. Jenny va au premier spectacle de la Comédie-Française. De 9 h à 11 h, je suis libre et seul dans ma chambre, où je fais un bon feu. Le maître d’hôtel m’apporte quelques sandwichs. Ce sera là tout mon dîner. J’écris mon journal -… [Passage publié dans le Ti 1, 302-303, 303-304] En habit, parmi d’autres habits, comme toujours, mais à Londres. S. Exc. M. Corbin accueille ses invités avec une courtoisie distante. On me montre Duff Cooper, l’ancien ministre du gouvernement Eden, et l’acteur Charles Laughton dont j’admire beaucoup le talent : lippu, bouffi, éléphantesque, avec une expression candide de gosse… Coup au cœur. J’ai reconnu le peintre Josselin Bodley qui fut autrefois notre voisin de palier, rue de la Pompe… Comme il paraissait vieux à l’enfant que j’étais ! C’était la folle époque de l’après-guerre. Je le revois agitant sur le balcon de son salon un éternel shaker. Mes parents allaient souvent chez lui boire des cocktails. Oui, je le revois, et avec lui le Mont Valérien dans le soir d’été où la musique d’un restaurant russe mettait sa douceur. Et je revois le parc ombreux des Carnot, et je revois Pasy, la petite Pasy Bodley, avec ses yeux bleus, ses cheveux blonds coupés en franges, ses joues roses… Si M. Bodley m’apparaît aujourd’hui jeune et beau comme un garçon de mon âge, Pasy surgit devant moi, méconnaissable … Première rencontre avec la vieillesse… Lorsque j’avais vu Pasy pour la dernière fois, elle avait 8 ans. J’en avais quatorze. C’était une enfant frêle, une toute petite fille… et voici une femme. Elle me sourit. C’est Pasy. Je cherche en vain sur son visage un trait qui fut semblable à celui d’autrefois. Je ne retrouve rien, rien de ce que j’ai connu… Et pourtant c’est la petite fille d’autrefois … Nous buvons du champagne. Un couple comme tous les autres. Elle est belle. Je suis en habit. Vertige de l’enfance évoquée. Et l’on a un peu honte d’être devenu cela : un couple comme les autres. « Vous me faisiez très peur, me dit-elle. Vous étiez quelqu’un d’important pour une petite fille. À vrai dire vous me sembliez assez monstrueux. Je n’existais pas pour vous. Vous ne me regardiez, ni ne m’adressiez la parole… » [Fin du passage publié] Et pourtant je l’aimais. Ce fut elle qui me fit éprouver pour la première fois (si j’oublie l’émotion où me mettait Claire Bourdet bien des années auparavant) ce que l’amour pouvait être. Je me souviens de ma honte éblouie. Aimer une fille, y avait-il rien de plus grotesque pour un petit garçon ! Et puis je me savais laid, je me sentais repoussant. Sa fragilité, la pureté de son regard bleu m’intimidaient. Si j’étais désagréable avec elle, c’est que je la trouvais trop jolie. Curieuse coïncidence qui me fait retrouver à quelque mois de distance les deux enfants qui furent mes voisines rue de la Pompe. Edith, Pasy ! Elles sont devenues l’une et l’autre de jolies jeunes filles que je pourrais aimer, et qui pourraient m’aimer… Nos amis anglais sont là : les Bartlett, les Mc Gowen, Mrs Turleight, Mrs Pitt-Rivers… Mais la Comédie-Française est arrivée aujourd’hui. Elle a donné ce soir sa première représentation. Voici des visages de Paris : Édouard Bourdet, qui me paraît vieilli, amenuisé, plus sombre que jamais. Denise, sa femme, belle, mais d‘une beauté figée et qui se survit. La charmante Madeleine Renaud qui se montre avec moi d’une amabilité extrême (ne suis-je pas le fils de son auteur ? Car la prochaine pièce est pour elle…) Le cher Pierre Bertin… Et Lise Delamare que je ne connais pas et qui me semble belle, et Denise Clair, et Brunau, et le petit Bertheau… Papa est fêté. Ce petit monde l’aime… (et il y a des raisons à cela…). Je dois rester dans les derniers puisque j’habite chez la maîtresse de maison. Jenny et une autre dame de l’ambassade (Madame Rocher ?) entourent M. Corbin de caquetages. Elles l’accablent d’égard et de frais. Il se retranche derrière une politesse souriante. Roland de Margerie, excédé, finit par en avoir assez. Il prend sur lui de lever la séance. L’ambassadeur délivré nous reconduit… Au lit à 2 heures. Les Bodley m’ont invité demain… Roland de Margerie arrive pour les repas, puis disparaît. […] La pauvre Jenny l’adore. Elle répète sans cesse sa joie d’avoir un si remarquable, un si bon mari. […] Un maladif besoin de bien faire, une soif de mouvement l’habite. « Que dois-je faire pour cette conférence, chéri ?… » « Ri-en », dit simplement Roland sans même lever la tête, mais en serrant les dents. Roland de Margerie a la cote. Il passe pour un diplomate de grand avenir. Il est intelligent, cultivé, avec un je ne sais quoi de trop dans l’expression de sa culture. Je suis déjà un familier de la maison. Jenny me trouve gentil. Elle me touche quant à moi beaucoup. […] … Amie dévouée, femme touchée. C’en est assez pour que ses faiblesses ne m’arrachent qu’un sourire sans méchanceté, une ironie plus tendre que blessante.
Londres, mercredi 1er mars 1939
Promenade seul à Hyde Park. Je fais le tour du lac, attentif aux couleurs estompées de cette matinée ensoleillée. Pigeons, mouettes, canards, cygnes et moineaux se disputent le pain des promeneurs. Là encore règne la force. Je demeure de longs instants à observer le vol mou des mouettes qui font du surplace avant d’aller happer dans la main d’un passant le pain offert, et celui rapide et précis des pigeons. [Passage publié dans le Ti 1, 305-306, avec quelques modifications] Déjeuner avec M. et Mrs Bodley et Pasy que nous avons été chercher chez Molyneux où elle travaille. « Savez-vous, m’avait-elle dit hier, simplement, que je suis mannequin chez Molyneux ? » « Travail monstrueux, avait-elle ajouté (elle aime ce mot). Il faut dès 9 heures du matin être en robe du soir, passer et repasser devant des clientes exigeantes… » J’avais admiré la simplicité avec laquelle elle me disait cela. Rien ne me paraît plus avilissant que cette sorte de prostitution. Et j’admirais cette jeune fille élégante et belle, de se plier, il le fallait bien, à cette nécessité… Pendant que nous déjeunons, Pasy me dit son horreur des richissimes clientes de Molyneux qui achètent pour les porter trois ou quatre fois des robes d’un prix « faramineux » (comme le mot est joli dans la bouche d’une anglaise !). « Elle devient communiste… », me dit en riant son père. Si jeune près d’elle il a l’air de son mari. […] Je regarde ce restaurant où des femmes élégantes et jolies déjeunent. J’évoque cette ville opulente où la souffrance des masses est si bien dissimulée qu’on n’aperçoit que des gens riches et qui dépensent sans compter. Et je pense : « Il faudra tout de même qu’un jour vienne où il sera remédié à cette atroce injustice, où il deviendra impossible de voir, dans le même monde, dans la même nation [suite de la phrase oubliée dans le Ti 1, 306, ce qui la rend inintelligible], dans la même cité, se côtoyer des êtres qui crèvent les uns d’indigestion et les autres de faim Il serait bon d’ouvrir les écluses afin que soit étale cette marée d’or, qu’elle recouvre également le pays humain tout entier. L’aisance et cette part de bonheur qui est compatible avec la vie, deviendraient générales… » Mais déjà je me laisse engourdir. Déjà je ne veux plus voir de Londres que ses journées douces, ses visages heureux… [Fin du passage publié] Nous raccompagnons Pasy à son travail. Mrs Bodley nous quitte. Son mari, très gentiment, m’emmène. Il me fait visiter des musées intéressants, mais qui ne m’apportent rien de nouveau, puis m’emmène prendre le thé dans sa minuscule maison proche du Musée des Sciences et du Victoria et Albert Museum dont nous venons ; son atelier est agréable ; Quelques-unes de ses toiles me paraissent plaisantes. Il est simple et affable comme tous les Anglais que j’ai vu ici. À 5 heures je passe à l’hôtel où je trouve mes parents. Papa me dit combien le hante aussi à Londres la disproportion écrasante de l’Argent. « Les pauvres gens sont légions, mais on ne les voit pas. Dans ces quartiers, l’or règne seul… Je suis oppressé, dégoûté, plus qu’à Paris honteux… » Maman et lui vont chez Lady Colefax. Je suis aussi invité et j’ai grande envie d’y aller pour rencontrer Rosamond Lehmann qui doit s’y trouver. Mais je suis fatigué, et puis il faut me mettre en habit avant dîner, et je n’ai que le temps… Dîner hâtif à l’issue duquel Jenny de Margerie, trépidante et tout émue à la pensée d’être présentée à la Reine Mary, m’enlève. Nous prenons chez elle Lady Wesley. (Je ne garantis pas l’orthographe !). C’est une vieille dame dont toute la gloire est d’avoir été pendant de longues années la maîtresse de je ne sais plus quel duc de sang royal. Spirituelle, mordante, avec un vieux visage marbré de bleu où la malice brille, elle fume sans arrêt, et ses 73 ans ne semblent pas ralentir son amour du monde. Jenny, très excitée, pose mille questions sur l’imminente faveur qu’elle va recevoir. D’insignifiantes questions de protocole la hantent. Elle s’est caparaçonnée de bijoux parce que « Queen Mary aime ça … ». Nous voici au théâtre du Savoy. Peu après notre entrée, la salle tout entière se lève, et la Reine-Mère apparaît au balcon de l’unique loge. Noble visage sous la tour des cheveux blancs, noble et pur visage, assez émouvant… Aussitôt après l’hymne national le rideau se lève… J’avais déjà vu ce programme à Paris. Je retrouvai dans L’École des maris cette amertume presque intolérable, cette cruauté méthodique qui m’avaient apporté naguère une telle gêne. Des rires nous sont extorqués qui nous déchirent. Mais Le Chandelier qui m’avait paru à la première audition sans grande valeur (je n’en avais su voir que les faiblesses) me donne un extraordinaire plaisir. Madeleine Renaud et Julien Bertheau y sont sublimes, très particulièrement dans la dernière scène dont la beauté me saisit si profondément que les larmes me montent aux yeux. Ne pas sourire de ces pleurs. Ils m’ont prouvé que je demeurais sensible et vulnérable aux choses de l’amour. J’avais des raisons d’en douter. Mon inexplicable endurcissement me torture depuis assez longtemps déjà. Cette impossibilité où je suis de perdre un instant ma lucidité. Cette obligation d’être toujours raisonnable, conscient. L’absence de la poésie vécue. La présence de l’esprit le plus clairvoyant et qui ne se laisse jamais duper… Douce illusion de ce soir. Oui, j’ai pleuré d’amour, j’ai connu à nouveau un moment ce vertige adorable. L’espoir n’est donc pas perdu… La salle retentit d’applaudissements passionnés. Puis la Reine-Mère se lève et le public debout l’acclame. La souveraine s’incline alors : ce sont trois petits saluts secs, rapides, distants, et pourtant d’une gentillesse touchante… Pendant l’entracte, j’avais vu M. Corbin introduire auprès de la souveraine Mme Bourdet, puis Jenny… La porte se refermait sur les élues et je me demandais pourquoi je subissais à mon tour cet envoûtement dont je me moquais pourtant il y avait encore un instant. Ce prestige attaché à la Cour, j’en connaissais la pauvreté sans pouvoir me défendre de le subir… Le Chandelier est fait de morceaux qui, pris individuellement, me paraissent puérils, faibles ou de mauvais goût. Que l’ensemble soit si parfait, si joli, si grave est la marque même du génie. Je sais tout ce qu’il ne faut pas écrire, aussi n’écrirai-je rien de grand. Le génie se moque des scories : le flot tumultueux de son verbe noie les impuretés. Du Bos écrit dans son Journal quelque chose de semblable. Il y a longtemps quant à moi que je me suis fais sur ce point une certitude. M. et Mrs Hudson reçoivent après le spectacle « to meet Monsieur Édouard Bourdet and the members of the Comédie-Française » (M. Hudson est ministre du Commerce extérieur.) Les acteurs sont là et je parle longuement avec l’adorable Madeleine Renaud qui me bouleversa tant ce soir. « Si vous saviez, me dit-elle, comme je souffre les soirs où il me faut jouer Le Chandelier sans être en état d’amour ! Comme je me sens indigne alors, et moche… Mais il y a heureusement les autres jours, ceux où j’aime vraiment avec toute ma chair le petit Bertheau pendant les quelques minutes que dure la scène finale… » Julien Bertheau jeune, non point laid mais étrange, avec je ne sais quel déséquilibre dans le visage et le corps. Pierre Bertin si amoureux de l’infidèle… Si ce fut gênant pour nous Français d’entendre les maris bafoués dans les deux pièces, ici à Londres, comme ce dut être douloureux pour lui. Je ne comprends pas le comique de cette situation et qu’elle serve de prétexte à des plaisanteries sans nombre échelonnées de siècle en siècle, m’étonne. (Comme m’étonne cet incompréhensible mythe de Don Juan : alors qu’il est si facile d’être aimé, et aimé de la femme qu’on désire…) Lise Delamare, agressive de coquetterie, et les charmants Bartlett, et la belle Mme de Barthas londonienne… Un visage renfrogné où les lunettes ont l’air de lorgnons. Un homme muet et seul que flanque une femme insignifiante. C’est H. G. Wells… Jenny se dépense sans compter. Elle veut me présenter le fils d’Hoffmansthal, la fille de Kipling. « J’ai horreur des enfants de grand homme », lui dis-je. Facilité du champagne. Lorsque nous sommes revenus à Eaton Square, il est plus de deux heures. Jenny, un peu alanguie, attendrie, prolonge la conversation, au bas de l’escalier. Je suis dans cet état ensommeillé et vaguement euphorique qui suit les fêtes : un animal.
Londres, jeudi 2 mars 1939
J’assiste devant Buckingham Palace à la relève de la garde. Émouvante parce que d’essence et de forme religieuse, la cérémonie se déroule avec une solennelle lenteur. Soldats mécanisés aux bonnets à poils prestigieux, musiques assourdies, mille rites minutieux, une pieuse application, et les spectateurs recueillis… De nouveau je suis gagné par cette contagieuse atmosphère, et lorsque le roi passe devant moi, qui sort en voiture du palais, et que je puis le voir saluer la foule qui d’un seul geste s’est découverte, je suis troublé… Je suis un moment les fifres allègres. Un détachement de gardes royales, dans leurs magnifiques uniformes rouges et à cheval, passe. On ne peut refuser à ce peuple une certaine connaissance de la grandeur. D’une certaine grandeur. J’achève la matinée à la National Gallery, où je passe une heure et demie, dans quel état de saisissement !
Déjeuner avec mes parents chez le critique Raymond Mortimer. Jeune, simple, intelligent, brillant. Mais je suis trop fatigué pour profiter de sa conversation. Une dame est là, catholique je crois. Comme elle demande ce que l’on peut reprocher à Franco du point de vue chrétien, mon père le lui explique. Avec une éloquence, une flamme dont je suis ébloui : « … Il n’était pas nécessaire, Madame, de compromettre la cause de Franco avec celle du Christ. Certes les évêques vont à nouveau là-bas habiter des palais, et l’on bénira les canons. Aucune importance si cela seulement importe : qu’aux yeux de toute une partie du peuple espagnol, la cause du Christ et celle de ce général qui a fait appel à des aviateurs étrangers pour bombarder ses frères, se confondent. Et cela, c’est d’une gravité, Madame, d’une gravité que vous ne pouvez mesurer… »
Au zoo avec papa et maman. Bouleversé par ces singes au regard si humain, à la tristesse si humaine, aux expressions d’hommes… Ô ce désespoir du néant de nouveau pressenti ! Rentré à la maison, je lis le Journal de Du Bos. Il y écrit à la date du 14 décembre 1927 : « … Ce n’est pas en croyant, mais bien en cessant de croire que je me renierais. Ma foi est le couronnement de tout ce que je pense sur tout, de tout ce que je sens sur tout, de tout ce que je veux sur tout… » Il en est, hélas ! de même de mon incrédulité. Comme j’aimerais avoir la foi ! Roland de Margerie nous apprend cette magnifique nouvelle : c’est le cardinal Pacelli qui devient pape sous le nom de Pie XII. Importance politique, importance religieuse considérables, et dans un sens dont on doit se réjouir comme catholique et comme Français. (Ici je réagis comme si j’avais la foi). Je téléphone la nouvelle à mes parents. Papa connaît le cardinal Pacelli. Il l’aime et en est aimé.
Dîner avec les Margerie et François Valéry. […]
Ce séjour s’achève. Je vais à Paris me retrouver moi-même. Je vais y reprendre l’indispensable travail. Mais il me faut ménager à côté du droit une place à la littérature (comme je déteste ce mot ! et pourtant il s’agit bien de cela, hélas !).
Londres, vendredi 3 mars 1939 [entrée dactylographiée]
Seul à la National Gallery, ce matin. Nouvelles découvertes. Mais mon émotion perd de sa fraîcheur : il y a des moments où je me demande même si mon admiration n’est pas feinte. Déjeuner seul avec François Valéry chez les Margerie, qui sont avec mes parents à un déjeuner officiel, à l’ambassade. Trop égocentriste, ne parlant que de lui, mais, ceci dit, intéressant, vivant, le petit Valéry m’est en définitive plus sympathique qu’antipathique, ce qui n’est pas peu dire.
Mes parents dînent chez les Margerie. Papa est brillant. Jenny simple : son mari est détendu, épanoui comme je ne l’ai jamais vu ; il n’a pas souvent dans son terrible métier l’occasion de s’amuser ainsi. L’étonnant personnage qu’est Simone André Maurois, née Caillavet, fait les frais de cette étincelante conversation. Les traits rapportés précisent mais en l’aggravant son visage. Je la savais déréglée : j’ignorais que sa folie pût avoir des conséquences si tragiques. Papa lit cette stupéfiante lettre qu’il reçut d’elle dernièrement. Simone y écrit que son fils, par adoption, Olivier a « en André le meilleur des pères » (ce qui dissimule déjà une rosserie terrible, car chacun connaît l’inexistence de cette paternité !), puis elle ajoute que son mari « est un bon homme de lettres, un excellent biographe, mais que le véritable écrivain, c’est vous… » Vous : François Mauriac. On se demande les raisons secrètes d’un tel aveu. Mais je souffre pour Maurois, je souffre en tant qu’homme menacé lui aussi du mariage et de trahisons semblables. Mon père rapporte qu’à l’époque où il connaissait à peine Simone, elle lui dit, un jour qu’elle était sa voisine de table dans un grand dîner : « J’ai trouvé des lettres qui ne laissent aucun doute : ni Olivier, ni Gérald ne sont les fils d’André. Dois-je faire part à mon mari de cette découverte ? » Horrifié, mon père l’en dissuada. Mais il la soupçonne d’avoir averti Maurois. Encore dût-elle ne rien lui apprendre. Mais elle a commis un geste encore plus criminel, du moins Mme de Margerie dit-elle que tout ce qu’elle sait le fait supposer (et surtout ses conversations avec le petit Olivier que les plus terribles doutes hantent) : elle a mis l’inquiétude au cœur de ses fils (par adoption). L’inconcevable snobisme de cette femme qu’aide une mémoire de fichier, son génie organisateur nous permettent encore de sourire. Mais depuis que Jenny a évoqué le visage torturé du petit Olivier, ce n’est plus de bon cœur… Les Margerie parlent ensuite, avec beaucoup d’humour, de leur étrange famille qui va d’André Germain à Maurice Rostand. Il faudrait avoir le courage de noter tout cela. Mais je n’ai pas le goût des potins. Les passionnants mémoires que je pourrais laisser si j’avais plus d’attirance pour les vaines histoires du monde, je ne regrette pas de ne pas les écrire. Bien plutôt suis-je triste d’accorder tout de même tant de place encore à ces pauvretés. La lecture du Journal de Du Bos me révéla l’insignifiance du mien comme document psychologique. Pourquoi ne consacrais-je pas plus de temps à ma vie intime ? La paresse, le manque de courage en sont cause pour une part, bien sûr, mais bien plus encore ce trait de mon esprit qui ne peut accorder quelque importance à ce qui l’émeut. D’où le bonheur relatif d’une vie qui accumule pourtant les motifs de désespoir. Mon père parle souvent, et cela me frappe beaucoup, des êtres qui ne sont pas assez intelligents pour transcender les raisons qu’ils auraient d’intolérablement souffrir. Je sais quant à moi échapper aux hantises parce que la notion du relatif ne me quitte jamais. Je ne mets pas l’infini dans ma pauvre personne. Je ne la crois pas immortelle, je sais surtout la modicité de son importance dans l’espace et le temps. Et la vie, la joie de vivre fût-ce dans la souffrance, me console de tout et de cette souffrance même. Je prends congé en sortant de table et, après avoir remercié les Margerie de la gentillesse de leur accueil, j’accompagne mes parents à leur hôtel, puis à Victoria Station… Nuit excellente dans le ferry-boat. De Londres à Paris en sleeping. Madeleine Renaud est du voyage. Je la trouve, lors de ses visites, d’une insupportable vulgarité. Et pourtant assez adorable… |
||